Littérature
Critiques littéraires
-
"La symphonie atlantique" de Hubert Haddad (éditions Zulma)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Dans ce roman construit comme une symphonie « traditionnelle », nous suivons le parcours de Clemens (fils de Frau Maria Anke Oberndorf) depuis Ratisbonne jusqu’au Mur de l’Atlantique, Clemens et son violon « comme un prolongement de lui-même ».
Hubert Haddad non seulement ravive « la culture allemande dévoyée par les nazis » (cf 4ème de couverture) mais dénonce avec fracas, ou avec la puissance explosive de la suggestion, les monstruosités d’un régime (euthanasie, enrôlement abusif de jeunes etc.) dans des séquences où le flamboiement de l’écriture épouse les déflagrations, où la quête du vivant transcende l’immanence contrainte dans son incomplétude.
Oui la musique résonne tout le long du livre comme l’expression de ce qui est invulnérable.
D’une part la construction rappelle celle de la symphonie, quatre parties, quatre mouvements, l’épilogue pouvant s’apparenter au « finale » La phrase elle-même obéit à des variations : elle peut s’éployer en une longue suite énumérative ou au contraire frapper par son laconisme alors que les conclusions de chaque chapitre ont la majesté des codas (une analyse approfondie le prouverait aisément) agrémentée de symbolisme ; d’une partie à l’autre peuvent se répondre en écho une même thématique (le voyage en train au début des parties II et IV par exemple) ou des phrases similaires (le phare de la Pointe du Hoc l’heure de la passée IV 2 et épilogue, reliant hier et aujourd’hui (car après un récit à la troisième personne Hubert Haddad donne la parole à Handa, rescapée des camps…)
D’autre part le personnage principal est un jeune violoniste, un virtuose, « l’ange musicien » (dira l’Oberstleutnant Grund) et tout au long du roman Clemens fait corps avec son violon (sans lui je n’existe plus confiera-t-il à sa professeure Susanne Fahrenholz) Son violon ? l’inestimable Jakobus Stainer légué par Maria-Anke sa mère persuadée qu’il le sauvera du « chaos » Cet ado disert en musique mutique en paroles a été à bonne école (sa mère le confie à Ratisbonne à une jeune étudiante en musicologie, Handa qui lui apprend à « tricoter les sons » » et plus tard esseulé (voire délaissé) chez l’oncle puis à l’Institut il continuera le « solfège » grâce à l’obstination du directeur…et la douceur de Susanne d’emblée séduite par la « pureté du son ».
Mais surtout le texte dans son entièreté vibre de notations de palpitations que rythment crescendos ou decrescendos alors que le monde alentour en guerre éclate en vrombissements hurlements crépitements (pleur d’enfer assourdissant) fortissimo répété de bombes huit accords… bruit de la ville avec en continuo ; Susanne sous les toits joue fortissimo un andante de Mozart (pense-t-elle amadouer les bombes ?) en fait la « mort jouait si près en « secret duetto » Clemens et sa « complice musicale » Susanne vont jouer la sonate en ré mineur de Schumann comme contrepoint d’une proche apocalypse en cet été 1943 avec cette intime conviction que la musique les a sauvés provisoirement.
La musique intègre ainsi avec fluidité le verbe quand il advient dans les énoncés quels que soient leurs contenus. Ainsi comparé ou comparant, la musique s’inscrit dans un jeu de métaphores ; la chevelure de Handa est « un poème symphonique roulant par vagues sur le clavier ; quand le concierge de l’Institut pleure la « disparition » de son fils Andreas et qu’il gémit « à l’heure qu’il est, il combat sur le front russe » sa voix se brise « comme l’archet sur une corde de sol tendue et les deux sombres lunes de ses yeux s’enfonçaient dans la nuit du crâne ». On murmure à l’oreille de Clemens un vers d’Hyperion d’Hölderlin et c’est une connivence une complicité avec Wilfried celles des lectures et de la musique. Wilfried avait vu en Clemens l’Ange en vert de Léonard et l’écouter jouer lui « révéla » un « cœur fraternel » Et bien que le sport soit privilégié (recommandation en haut lieu) le directeur de l’Institut amoureux du musicien Ludwig Schuncke ne capitule pas et… le solfège continuera à être enseigné (avec certaines mesures restrictives) et voici que les instruments -piano au bois d’épicéa lustré et verni rappelant celui de Handa, harpe, se muent en anamorphoses comme en des fondus enchaînés.
Après les travaux de « décombrements » et l’épouvante du contact avec la mort (Clemens est alors âgé de 14 ans quand il côtoie des corps démembrés) la musique est seule capable de « désarmer ses cauchemars » bien que le fantôme de sa mère le hante… La musique reste sourde aux harangueurs ; et quand bien même tous les compositeurs juifs sont interdits (dont Mendelssohn) Susanne sait qu’elle et son élève complice peuvent se « retrouver » dans un « rêve », dans l’endormissement même Plus ou moins protégé par l’Oberstleutnant (alors que celui-ci est convaincu que la musique doit endurcir les mœurs) Clemens (ne ressemble-t-il pas à un angelot d’un tableau de Rosso Fiorentino) qui avait vu « s’envoler les vies s’éteindre le jour et flamber les nuits » va se diriger - à son insu - vers cet océan qui à marée haute rameute les abysses avec les nuées comme étendards » et il assiste à l’opéra grandiose des éléments. Un océan en furie qui lui rappelle le feu des bombes. Ligne de défense ! Atlantikwall. Ainsi se trouve justifié l’emploi de l’épithète « atlantique » dans le titre du roman Oui Clemens aurait aimé composer une symphonie pareille à l’Atlantique, la donner à entendre à travers les temps aux disparus.
A travers le parcours de Clemens c’est bien le destin d’une jeunesse sacrifiée (mot d’ordre obéir et combattre sans faillir ; enfants recrutés sans préavis avec l’aval contraint des familles) qui est évoqué avec fougue et émotion, destin dont s’enrichit le panthéon culturel convoqué… Certes l’enfant aura eu le « privilège » de ne pas être embauché très tôt dans les jeunesses hitlériennes » grâce à ses dons de virtuose…
Mais à 15 ans sur les côtes normandes le jour du « débarquement » Clemens entend le leitmotiv du glas de laSiegfrieds Trauermarsch, et il va caler son violon au creux de la clavicule.
Ecoutons les accords qui perpétuent le miracle suspendu de la musique longtemps après qu’une simple balle de colt 45 a frappé au cœur l’enfant sans secours.
Ecoutonsle gracile frémissement des feuilles d’érable dans la lumière du printemps…
-
Le soldat désaccordé de Gilles Marchand (éditions Forges de Vulcain 2022)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Prix des libraires, prix Eugène Dabit, prix Naissance d’une œuvre
Chronique de la première guerre mondiale ? Gilles Marchand l’évoque avec une certaine originalité dans le roman « le soldat désaccordé ». Il donne la parole à un jeune combattant mutilé, chargé par une certaine Mme Joplain de retrouver son fils Emile disparu en 1917. Et il entraîne son lecteur dans une enquête en forme de jeu de piste. Une narration à la première personne où se conjuguent le sublime -un roman d’amour absolu- et le grotesque absurde -les horreurs de la guerre-, le poétique et le réalisme, le lyrique et l’humour, le passé et le présent de « l’écriture, où l’enquête se mue en quête de soi, où s’enchâssent plusieurs récits restitués dans leur tonalité particulière jusqu’à leur effacement dans la révélation quasi épiphanique -celle du soldat désaccordé. Hoquets de l’histoire et chanson d’amour, aveuglement inhumain et cécité lumineuse de qui actionne le soufflet de l’accordéon…
C’est un matin de 1925 que ça a commencé. Avant cette date le jeune soldat parti sans fleur au fusil perd une main en 1914 (plusieurs flash-backs s’en viendront préciser les circonstances), infirme besogneux jusqu’en 1918 puis formé par Blanche Maupas pour « enquêter » (aider les familles à retrouver père, mari, fils…). D’ailleurs son enseignement : méthode, abnégation, sens du détail, réseaux, importance de l’opinion publique, il l’applique méticuleusement dans son enquête sur Emile Joplain. Du témoignage d’Emile Moriceau (Melun) à celui des parents de Lucie (Alsace) en passant par ceux de Richard Letoile, d’Adolphe Menu (le choix du prénom n’est pas innocent) Henri Bourdon (Arras) bénéficiant aussi de l’aide précieuse de Davisse, archiviste obsédé par les chiffres, il parcourt la France et en fouillant les mémoires, les archives et les champs de bataille, il tente de recoller les morceaux d’un puzzle. La première révélation : la passion de l’écriture qui a toujours animé Emile Joplain n’est pas anodine (message subliminal sur la création littéraire, sa fonction cathartique ? ou autre ?) et c’est bien de ses lettres d’amour que se souviennent les « témoins » -alors que la mère est dans le déni (préjugés de classe…). S’imposera dès lors l’histoire de Lucie et Emile, celle d’un amour qui a défié tous les obstacles et que le bourbier n’aura pas terni… Muse Bien-Aimée, Fille de la Lune ô l’enchanteresse qui ponctue le texte de ses poétiques récurrences.
Le texte est traversé aussi par des effets spéculaires, des échos intérieurs : à l’acharnement du narrateur dans sa « reconstitution » répond celui de Lucie dans sa « recherche » de l’aimé, (au tri postal, sur le front auprès des blessés) ; au sens de l’observation de l’écoute répond celui d’Emile aidé par l’Amérindien (observer, repérer, comprendre les conversations, noter tout, communiquer rapport). Mais surtout le parallélisme entre sa relation avec Anna et la relation Emile/Lucie non seulement justifie la durée de l’enquête (10 ans) mais transforme l’enquête en quête de soi. Et voici que battant sa coulpe le narrateur « revit » ces quatre années où la certitude d’œuvrer auprès de ses « camarades » du front (payer une dette ?) l’a emporté sur son amour pour Anna « pendant que Lucie Himmel traversait le pays pour retrouver son fiancé je m’accrochais au front pour fuir mon Anna (« mon Anna rêvée pendant quatre ans, partie en quelques heures »). S’interrogeant sur le « sort » réservé aux Alsaciens (depuis l’annexion par les Allemands en 1870) il en vient à remettre en cause la pseudo-délivrance qu’une victoire française allait leur octroyer… Et quand se profile la menace d’une « autre guerre » alors que l’intox affirmait c’est la der… la vision des « corps sans tête des bouches sans personne (…) des morceaux de canassons extraits d’homme est une horreur ; l’histoire des cinq moustaches ou le rire jaune du désespoir !!
La phrase crépite se love et voici l’horreur résumée en un saisissant raccourci « dans le ciel c’était le feu. Le feu et les cendres. Sur la terre c’était les secousses et les tremblements. L’antichambre de l’Enfer » Symphonie du massacre ! Mais souveraine la permanence de l’amour inviolé dans l’impermanence.
Dans ce bourbier et dans le maillage « souterrain » des consciences habitées par l’espoir, le narrateur débusque souvenirs mensonges fantasmes non-dits secrets que la parole va exhausser ; méandres et circonvolutions, à l’instar d’ailleurs des allers et retours de cette Fille de la Lune zigzaguant entre le jour et la nuit, entre l’Ombre et la Lumière. Alors que sont convoquées de grandes figures de la mythologie ou de la littérature (ce qui permet au lecteur de pénétrer dans le panthéon littéraire du romancier). Et si l’on se réfère à la page « remerciements » on mesurera l’importance de la documentation dans l’élaboration de ce roman.
Un roman ancré dans une période précise certes -et dont certains rappels teintés d’humour sont les signaux -mais la voix du narrateur, celles des intervenants, l’évocation des destins brisés, des vies cabossées, lui confèrent une portée universelle…
N’est-il pas dédié aux victimes de la guerre, de toutes les guerres ? (cf page remerciements)
-
« Nord Sentinelle » de Jérôme Ferrari (éditions Actes sud)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Contes de l’indigène et du voyageur
Premier volet d’un triptyque consacré àl’altérité, Nord Sentinelle s’intéresse à l’une des manifestations les plus ostentatoires de ce face à face entreles habitants d’une terre et ceux qui viennent la visiter « le tourisme ». Nord Sentinelle est le nom d’un archipel du golfe de Thaïlande, -où les habitants gardiens séculaires de leurs terres, empêchent toute velléité d’incursion ; le sous-titre (et la table des matières subdivisant en « histoires » chacune des cinq parties, le confirme) orienterait la lecture vers le récit de contes légendes… Fiction et réalité ?
Si la Corse n’est jamais nommée, l’histoire des Romani, d’Alexandre le tueur, le transfert par inversion entre image et réalité (le code de l’honneur), le rôle d’un narrateur omniscient et témoin, amer et désenchanté, vont relier étroitement l’histoire événementielle de l’île à l’Histoire… Dans un récit à la chronologie éclatée, mêlant plusieurs techniques narratives et alternant deux typographies, Jérôme Ferrari analyse, avec férocité souvent, la perversité du jeu entre l’indigène et le voyageur, entre le Corse et le touriste ; et le narrateur condamné à « survivre » dans un contexte qu’il fustige, en acceptant l’inacceptable, ne peut être animé que par la colère.
Écoutons cette tragédie des temps modernes, scandée par la reprise récurrente « on raconte ». Osons franchir avec le narrateur la « porte close » de cette bergerie qui abrite les fantômes pour « les nuits à venir » tout en prenant nos distances avec ses prétentions et ses excès dans la détestation de ses semblables.
L’exergue emprunté au « voyageur » Burton -celui par qui le « scandale » est advenu dans la ville sainte de Harar car le sultan, hôte bienveillant, n’a pas accompli la prophétie…-, inscrit d’emblée le roman dans un contexte historique et philosophique et dans une diatribe contre les intrus, les touristes… Il se déploie en cinq parties dont les titres -des extraits de phrases incluses dans le récit- ont la grâce du merveilleux (ton corps de myrrhe et de jasmin, la porte bleue du sultan) ou la cruauté du cynisme (il peut mourir deux fois). Contextualiser l’acte « monstrueux » du jeune Alexandre (il vient de poignarder un touriste) non pour le justifier mais pour dénoncer un état d’esprit propre aux Romani incultes, fiers de cette inculture. Nourri par une mythologie, qui a idéalisé ses aïeux, le jeune Alexandre ce « bon à rien » se doit de ne pas se laisser bafouer dans son « honneur »… Or Alban l’a humilié deux fois ! Cette « scène inaugurale » sera déclinée en des formes multiples sous des angles et selon des points de vue différents. Evoquée dans chacune des cinq parties, elle épouse leur tonalité spécifique ; elle s’enrichit à chaque fois de détails susceptibles d’aggraver ou non l’homicide. Elle permet au narrateur d’exhumer des bribes de son passé (lui l’amoureux de sa cousine à la robe de myrrhe et de jasmin Catilina et mère du tueur) en mêlant temporalités et temps verbaux, ou de « refaire » l’histoire (irréel du passé, si le narrateur avait eu un fils !). La « scène » est restituée dans ses prémices lors d’un interrogatoire, quand Shirin la petite amie de la victime Alban Genevey est convoquée pour « témoigner » -- chapitre où le romancier introduit le « fantastique » en la présence d’un Djinn reliant Harar et la banlieue parisienne. Mais surtout elle se superpose comme dans un fondu enchaîné à celle de Burton et du sultan. Ce qu’accentue la circularité du roman qui s’ouvre sur l’épisode de 1855 et se clôt sur la tentative d’Alexandre, de rejoindre sa mère, après avoir franchi la porte bleue, en cette nuit du mois d’août d’où l’observent les yeux sombres du sultan. Dans la très longue phrase en italique, où le narrateur s’adresse à son petit cousin pris dans un « engrenage mortifère, la prose poétique frémit d’une compassion insoupçonnée, (le sang qui fait de toi un faible, comme moi) tout en fustigeant tous les « damnés »…
De longues phrases dont la complexité ne saurait nuire à leur fluidité, des passages empreints d’un humour léger ou parodique (la vérole australe, le bœuf psychopathe, l’équin démoniaque, la répulsion de Shirin pour les « bouches » après le port imposé du masque…) ou plus corrosif (clivage des classes sociales, démence des touristes) un mélange des tonalités (des scènes cocasses côtoient la tragédie) et des « genres » narratifs, un enchevêtrement de poésie et de réalisme cru, des effets spéculaires et/ou des variations, autant de procédés (typiques de l’écriture de Jérôme Ferrari) pour mettre en évidence et illustrer ce constat « chaque possible porte en lui sa souillure » -le chagrin souillé d’un lâche soulagement, le soulagement souillé d’un irrémédiable chagrin » ou pour affirmer et prouver que l’enfer (cf l’épisode du team building) ce n’est pas seulement « les autres » (les voyageurs les touristes abrutis) mais aussi les « indigènes » dont il fait partie… Lui qui aura voyagé (vu des mers d’une étrange couleur,) lui qui aurait pu suivre l’ombre du capitaine Richard Francis Burton, lui qui, Ulysse des temps modernes ne reconnaîtra pas son Ithaque natale déformée défigurée par l’invasion du tourisme de masse.
La tuerie de Pierre Marie Romani (dont le père fut si fier…) le geste d’Alexandre son arrière petit neveu, fonds abyssaux de la déchéance morale ? antique malédiction d’une folie guerrière ?
La reproduction d’un masque mortuaire de Napoléon offert par Eugénie (sœur de Pierre Marie) au narrateur bachelier -ce masque hideux monstrueux avait dit la mère, restera posé sur son bureau comme l’élégant vestige d’une époque de splendeurs révolues.
-
« Les tourmentés » de Lucas Belvaux (Alma Editeur)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Prix Régine Deforges du premier roman 2023
Acteur réalisateur scénariste, Lucas Belvaux signe avec « Les tourmentés » son premier roman. Salué par la critique, auréolé de plusieurs prix, ce récit d’une chasse à l’homme (intrigue qui renouerait avec certains films connus du grand public ??) fait alterner plusieurs points de vue. Ce procédé qui laisse libre cours à une analyse explicative ne cherche nullement à emporter une quelconque adhésion ; tout au plus mettre en évidence la complexité du comportement humain quand il est tiraillé entre des objectifs contradictoires, quand il est écartelé entre des impératifs antinomiques. Le récit est ainsi celui d’un itinéraire intérieur, celui de « tourmentés » aux prises avec les principes essentiels de l’existence : Vie et Mort, Vie et Amour.
Le roman s’ouvre sur un constat dont le laconisme et la froideur peuvent surprendre « La vie. La mort. La même chose » et ce chapitre inaugural se clôt sur une reprise où un destin particulier s’inscrit dans l’universelle destinée « Ma vie. Ma mort. La même chose » avant cette fonction « phatique » du langage « je m’appelle Skender » ; à laquelle répond le tout début du chapitre 2 « je m’appelle Max ». Skender et Max s’étaient liés d’amitié à l’époque des guerres menées sur plusieurs fronts (dont l’Irak) quand ils étaient légionnaires… Le premier s’est clochardisé, le second, entré au service de Madame, doit « fournir » une proie humaine – contre rémunération- sur laquelle cette « veuve fortunée » exercera ses talents de chasseresse « Madame a chassé tous les gibiers. Sauf l’homme »
Entre l’adoption du contrat par les parties prenantes et son exécution, six mois vont s’écouler…
Ici, les indices temporels (6, 5, 4, 3 mois) ne sont pas simples repères chronologiques, ils ont une fonction dramatique liée à la conscience aigüe d’une mort prochaine 6 mois de sursis 6 mois de vie intense de plaisirs retrouvés 6 moispour réorganiser sa… vie tel sera le programme de Skender ; se comporter en « bon » père avec ses deux fils Jordi et Dylan, en « bon » époux avec Manon, comme pour se racheter, lui qui avait menti, délaissé abandonné les siens. Memento mori.
Car le temps dans ce roman est à la fois motif littéraire, dramatique et philosophique. Le jeu avec les temps verbaux (passé, présent et futur) et l’abondance d’interrogatives ou de modalisateurs le prouveraient aisément.
Lambeaux d’un passé douloureux ressuscité (vision apocalyptique des champs de bataille, emprise pédophile de celui qui sera l’époux de Madame), questionnements, doutes harcèlent les trois -quant à l’exécution du projet quant aux conditions requises, quant au « devenir » - ils se « traquent » avec la précision du « chasseur » tout comme ils traquent leur passé leurs fantômes, et le choix de l’alternance des points de vue qui se déploie en 86 chapitres (incluant Manon et Jordi, avec une énonciation à la première personne, avec des choix lexicaux et des tournures syntaxiques propres à chacun) ne saurait se limiter à une sorte de polyphonie ; interpréter une scène identique d’un point de vue particulier (comme dans la trilogie Un couple épatant, Cavale, Après la vie) ? Certes. Mais aussi pénétrer la psyché de l’autre, le sonder, « voir » ou « imaginer » ce qu’une forme de cécité lui interdit de faire advenir et grâce à cet entrecroisement le lecteur assiste à des changements plus ou moins notoires il « voit » s’accomplir les métamorphoses, il est à même de « comprendre » en pénétrant limbes ou parties semi obscures de chacun. Tout en constatant que le romancier aura privilégié l’analyse introspective de Skender… cet homme aux abois qu’il fait accéder à la… lumière.
L’écriture de Lucas Belvaux change elle aussi au cours du récit (qui de fait sera celui de métamorphoses). Aux phrases sèches -souvent nominales- du tout début vont succéder des phrases plus amples, aux interrogatives si abondantes, voici des phrases plus déclaratives. Et les rares dialogues sont restitués selon une disposition typographique particulière qui les isole du récit… dans lequel ils sont censés s’insérer, l’espace, le blanc de la pause, devient celui du sous-entendu ou de la temporalité !!
Les rêves éveillés de Skender imaginant ses enfants disposer de la fortune mise à leur disposition, avant de disparaître je leur fabriquerai des souvenirs heureux il me reste 4 mois pour leur léguer ce désir-là. Manon ou Jordi tentant de « comprendre » l’incongruité de la métamorphose de l’époux et du père, tout en lui dédiant un amour indéfectible, la contemplation des méduses à l’aquarium, autant de passages qui forcent l’empathie !
À la question, Ça vaut combien une vie qui ne vaut plus la peine d’être vécue ? Une vie d’invisible sans amour, à la lisière du monde… le parcours de Skender est la réponse, dans ce récit qui tient autant -sinon plus- du roman d’analyse psychologique que du thriller !
À l’incipit La vie. La mort. La même chose
répondra l’explicit La vie. L’amour. La même chose
-
« Parfois l’homme » de Sébastien Bailly (éditions Le Tripode)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Composé de huit parties, elles-mêmes subdivisées de 001 à 110-, parties dont les intitulés renvoient à une tradition romanesque en vigueur au XVI° (cf Rabelais), ce premier roman de Sébastien Bailly entraîne le lecteur dans l’aventure d’une vie, celle de l’homme, itinéraire qu’il explore depuis sa naissance jusqu’à sa mort (l’homme, jamais identifié, l’homme un double, un frère). Procédés d’accumulation, attention portée à la quotidienneté la plus ordinaire : le lecteur sera sensible aux clins d’œil à Perec, au mélange de sérieux et d’humour, aux jeux de sonorités, à ces références inscrites avec l’élégance de la connivence, à l’intérieur même des phrases. La littérature convoquée naturellement comme allant de soi sans faste et sans fard…dans cette succession de tableautins, dans cette dissection de « la condition de l’homme (?) contemporaine », dans cette marche jubilatoire vers… un degré zéro de l’écriture barthien ?
L’aventure d’une vie de la naissance à la mort ! Naissance dont l’homme se souviendra, tant « on » lui aura raconté l’histoire « où quand comment » avec force détails, et péripéties, saugrenues parfois ! Parfois : cet adverbe selon sa place -avant ou après le substantif « l’homme » - selon qu’il est précédé suivi ou non d’une virgule, n’aura pas la même acception ; l’homme parfois a 17 ans, ; parfois, l’homme envisage ; parfois l’homme se prend de passion... Adverbe relayé par « le plus souvent » ou « de tout temps » (la charge ironique est plus ou moins patente selon le contexte). Mais à l’initiale des paragraphes et des phrases qui le composent, s’impose l’énoncé « l’homme ». L’homme à la fois abstraction générique et « genre », l’homme sujet ou victime, celui qui impose ou subit, l’homme si comique dans des situations burlesques à la Keaton ou à la Tati. L’expression « première fois » impulse l’analyse (souvent savoureuse) du premier baiser, de la première passion, de la première conduite au volant d’une voiture (qui correspond avec un premier (?) rendez-vous amoureux) du « premier propriétaire » du « premier cadavre » du premier cercueil, du premier pas dans la délinquance… de la première interpellation « Monsieur ».
Quel que soit le parcours, quelles que soient les circonstances (tous les cas de figure Sébastien Bailly les envisage telles des contingences, tels des possibles, dans des phrases accumulatives ou dans la succession de phrases courtes, parfois nominales, au rythme rapide) ; quelle que soit l’époque (avec cet ancrage évident dans le monde contemporain où on n’utilise plus « les mouchoirs en tissu » où on télécharge des séries où l’on risque d’appeler son enfant par le nom d’une marque où l’on porte un jean déchiré au genou, l’auteur n’est pas « tendre » avec « l’homme » (moqueries acerbes qui le ridiculisent très souvent en mettant au grand jour ses lâchetés ses bassesses ses maladresses) mais il sait manifester une certaine empathie (compatir à la douleur de qui a perdu un être cher).
En fait n’est-ce pas surtout son humour « pince sans rire » qui rend si plaisant en le dédramatisant, le déroulé de la narration qui se confond avec celui de la vie ; humour qui éclate en rire franc au détour d’une fausse interprétation ou telle une clausule à effet en fin de paragraphe. Très souvent en surplomb (à l’instar de l’homme sur une tour en haut de la grue) l’auteur « refait le point » « ajuste la focale » de ses « jumelles » grossit un détail se plaît à imaginer (ou conjurer). Tel un entomologiste il analyse dissèque, il anticipe (la crise de la quarantaine annoncée dès le § 011 « nous en reparlerons »). Il revient en arrière (les lacets, le pied dans la bouche, le choix des prénoms) tout comme l’homme cinquantenaire devenu se souvient, feuillette les albums photos, relit les agendas du passé…
Adepte de l’auto dérision il s’immisce met en garde (l’auteur serait bien avisé de profiter d’une parenthèse pour rappeler qu’il s’agit ici d’une œuvre de fiction afin d’espérer échapper à une bastonnade en règle) et critique sa phrase tortueuse… Lui, l’amoureux des mots, invite le lecteur à entrer dans l’univers de la création. Le questionnement sur les choix lexicaux sur l’agencement le rythme de la phrase commence très tôt et « l’homme » -alors qu’il est « majeur » - se montre très critique envers sa « création » de préadolescent (phrases pauvres, vocabulaire restreint, écriture malhabile ; des jugements péremptoires et cette façon de se regarder le nombril).
Des expressions prises au pied de la lettre (décrocher un job puis prolongement avec les abeilles, laisser passer un coche) des zeugmas (sentait l’ail et la rancœur) des emprunts à Verlaine Rimbaud Nerval (entre autres) insérés tout naturellement dans un énoncé, une composition qui rapprochant l’homme de son tombeau ira mezza voce -scandée par l’anaphore « l’homme est assis devant la baie vitrée » tout en préservant une forme de cinégénie (cadre plan mouvement discours indirect) dans la construction de chaque contingence, une mise en abyme (paragraphe 105 où l’on voit l’homme « cherchant sa première phrase pour écrire sa vie faite de potentialités explorées ; une Vie à coucher sur le papier et à faire lire), ainsi se communique le plaisir d’écrire qui devient plaisir de lire…
-
CÉZANNE : des toits rouges sur la mer bleue, de Marie-Hélène Lafon (éditions Flammarion D’\Après)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Cézanner (robuste verbe du premier groupe) pour entreprendre un « colossal » chantier ? D’emblée Marie-Hélène Lafon met en exergue sa nécessité. CÉZANNE : des toits rouges sur la mer bleue, ne sera pas une biographie académique avec une tendance à l’hagiographie mais un ensemble de « variations », de « ruminations ». Embarquée en Haute Cézannie la romancière parcourt le « pays premier » ; ses labyrinthes « familiers et familiaux », ses sous-bois, et le « portrait » composite qu’elle propose (après plusieurs décennies de « travaux ») est une « peinture », un « tableau », avec variations sur les angles de vue, à l’instar des « toits rouges sur la mer bleue » (déjà cité en exergue du roman Joseph 2014).
Le texte est composé de cinq chapitres -ou parties- aux titres révélateurs -familles, sous-bois, dans l’atelier fendu, aller au paysage, écrire peindre (la toutedernière page en guise de remerciementsdit avec humilité « ces ruminations cézaniennes ont été nourries par ..). Autant de plaques tectoniques dont rendent compte d’ailleurs l’éclatement de la chronologie, l’alternance -au niveau typographique- entre graphie inclinée (italique) et graphie en romain (caractères droits), l’insertion de lettres ou extraits de correspondance datée et l’adoption de différents points de vue (avec changements de registre de tonalité et de choix lexicaux)
Au début de chaque partie, en italique Marie-Hélène Lafon évoque (énonciation « je ») une démarche, sa démarche, les circonstances personnelles qui ont contribué à élaborer le « chantier » (visites, expos par exemple ou atelier des Lauves juin 2022). Elle commente certains tableaux à la lumière de ces prémisses, revit, comme habitée, la présence de l’artiste (atelier), compare hier à aujourd’hui (il y a désormais une station Cézanne une avenue Cézanne (nom hier raillé désormais porté au pinacle). Ou bien elle explicite des expressions chères au peintre « aller au paysage » (véritable corps à corps ; saisir en frontal le lieu le vent la lumière, engager son corps, son être tout entier ; (l’endroit de « jouissance est le paysage ») ; refaisant le parcours du peintre (en ce 24 octobre 2022) aux entours du cabanon, des carrières de Bibémus ; elle imagine des artistes allant avec leur barda au motif, faisant corps avec les paysages traversés courtisés apprivoisés tout comme elle-même fait corps avec son écriture, son chantier -en (re)découvrant la rivière l’Arc, les lancinants sous-bois, la Sainte Victoire à la carcasse antédiluvienne échine longue et plissée mufle croupe massive et aérienne ni agreste ni champêtre ni pittoresque érection géologique dardée définitive et impavide.
Un détail révélateur peut impulser le commentaire. Ainsi l’échelle, dans l’atelier de Cézanne, rappelle celle de la cour dans la ferme des parents de la romancière ; l’échelle comme métaphore de l’ascension sociale tant désirée par le père Louis Auguste ? Or l’échelle a contribué à « cézanner » bien avant l’ouverture du « chantier » : une telle présence ne peut être apocryphe ; l’échelle renvoie aussi au corps du peintre, à sa ténacité, son ardeur « je suis vieux malade et je me suis juré de mourir en peignant »
Puis elle contextualise en insérant des extraits de correspondance (lettre du père au docteur Gachet, du fils Paul à sa mère entre autres) ; dès lors elle va se mettre « à la place de l’autre » le professeur Gachet à Auvers -sur-Oise en cette année 1873, la mère en cette année 1874 le père en cette année 1886, Hortense la femme épousée en 1886 en ce jour de 1897 le jardinier 1906. Elle tente pour chacun (graphie en romain) : de mettre en adéquation la présumée psychologie, le statut social et la façon de s’exprimer -la mère imagine les « modèles » nus de femme (en atelier) se rappelle la façon dont son fils lui parlait des tableaux admirés au Louvre, préfère les saisons au portrait d’Auguste (le « fini »… on a en mémoire la visite au Louvre des invités de Gervaise après le repas de noces… dans l’Assommoir de Zola) ou encore le père moribond qui vient d’apprendre par sa fille Marie que son fils Paul s’est enfin marié. Se profilent des préoccupations de parents (sur l’éducation, les préférences que la bienséance et les traditions empêcheraient d’afficher). Si Hortense avoue ne rien comprendre à la peinture elle affirme péremptoire que Monet et Renoir savent leur métier… alors que Cézanne… !! elle qui a posé comme une pomme pour les 45 portraits aura su déceler dans le rendu, la présence d’une seule oreille. À l’inverse, le jardinier est plein de déférence (presque de la dévotion) à l’égard du maître, il aime se familiariser avec le vocabulaire technique (palette chevalet) ; certes il a tendance comme Hortense, ou la mère et le père de Cézanne, à juger en fonction de la ressemblance avec le « réel » ; mais il devine (intuitivement) la présence d’un mouvement, la danse de la lumière et ses longues séances de pose, il les assimile à des «voyages » -Marguerite, sa bien-aimée il la réinvente en la convoquant dans les sous-bois-, et il avoue in fine que le jardin de Cézanne est son préféré car c’est avec lui « qu’il aura appris à voyager immobile ».
Dans les « portraits » de chaque intervenant la romancière excelle plus ou moins. Hortense lui échappe et d’ailleurs ne l’a-t-elle pas avoué dès le début ? Car si la construction de chaque chapitre est formellement identique,» le début contient le tout comme dans les « variations » (musique) Lauves, haute Cézannie ; demander le père puis le fils bancal, la mère, les deux sœurs, la concubine Hortense ; (reste le vivant souvenir des sous-bois des baigneuses des sainte victoire, et le tout peut être dans la partie (comme dans certains tableaux) reste la carte à jouer des toits rouges sur la mer bleue (sous-titre repris en écho au début du dernier chapitre Ecrire. Peindre)
Marie-Hélène Lafon dit avoir choisi Cézanne, cet homme aux abois, affolé, au ras des choses. Elle est « allée vers lui » comme on « va au paysage » « à corps perdu » (cf 4ème de couverture)
Ecrire, peindre, - titre de la dernière partie-. ou la simultanéité de deux actes créateurs à défaut de leur confondante unité ?
La peinture est dans la sensation, la ressemblance n’est rien.
-
"Qui après nous vivrez" d’Hervé Le Corre (éditions Payot Rivages)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Composé de 23 chapitres, où se télescopent différentes temporalités, avec comme toile de fond les conséquences désastreuses dues aux épidémies, à la crise climatique, aux pénuries, l’auteur nous projette dans un futur proche, infernal et inhumain. Uchronie (ou dystopie ?) dont le titre est emprunté à la Ballade des pendus de F Villon. Le « vous » inclus dans le futur « vivrez » est-celui de Rebecca Alice Nour Clara. Ces femmes dont nous allons suivre sur plusieurs générations le parcours tortueux et tourmenté dans un récit à l’éclatement chronologique. Femmes qui ont légué un savoir, des récits, cette peur chevillée au corps, et cette attente d’un jour qui se lève, faire déferler la lumière pour dissiper à jamais la nuit.
Clara, l’arrière-petite-fille de Rebecca ne comprenait pas (en ce XXII° siècle) que les gens des temps-là (début XXI°) n’aient rien fait pour empêcher le désastre annoncé depuis longtemps
Qui après nous vivrez : unroman avertissement ?
Léo et son père Marceau, Clara et sa mère Nour, c’est sur ces deux couples que s’ouvre et se clôt le roman. Si la fresque de Nour-que nous découvrirons au cours du récit- présente 6 personnages c’est que la mère de Léo et le mari de Nour, bien que morts, continuent de cheminer avec eux. Comment Nour et Marceau se sont-ils rencontrés ? Nous ne l’apprendrons que vers la fin du roman : tel est un des effets d’attente ou de suspense dus précisément à un éclatement de la chronologie.
2120 ( ?) Un double enjeu narratif. Ouverture du roman et simultanément introduction de thèmes majeurs : la blessure originelle, le trauma de Léo enfant, la danse de Clara, la transmission de pouvoirs divinatoires (Clara magicienne tout comme sa mère Nour ou sa grand-mère Alice), un univers calciné, un monde dévasté par des épidémies, des guerres, l’omnipotence de hordes sauvages-, le doute quant à l’existence d’un passé, la présence fantomatique d’un chien, une survie faite d’errance forcée avec parfois des haltes comme dans cette maison du début. A la fin du roman les quatre personnages après de douloureuses errances, sont « épuisés mais vivants (« ensemble, on ne se lâche pas, on est enchaînés ») ils savent qu’« il y a encore du chemin à faire »…
Si la fin du premier chapitre coïncide avec l’ensommeillement des quatre personnages, le début du suivant est un retour en arrière de presque un siècle. Le soir où tout a basculé. Rebecca Martin et leur enfant Alice. Au 15ème étage d’une tour. Chaleur torride. Panne géante d’électricité et plus rien ne sera comme avant…Martin ne rentrera pas du dispensaire le lendemain, Rebecca après des vaines recherches est contrainte à l’exil…
Le roman alterne ainsi une double errance (aux allures d’épopée et/ou de western) celle de Nour/Clara et celle de Rebecca/ Alice avec retours en arrière analepses ou prolepses alors que de rares chapitres sont dédiés uniquement au « destin » d’Alice/Selma. Or le monde dans lequel évolueront Alice et Nour présente des similitudes avec celui de Rebacca (mère et grand-mère) après la Catastrophe (2050 ?)…ce dont témoigne un jeu constant d’échos et de miroirs, ce que confirme Rebecca concernant sa fille Alice à 8 ans a déjà vu les misères insondables les nuits de terreur sans fin les charniers
Univers de damnés claudicants, monde carcéral du Domaine (étranges ressemblances avec les camps de concentration du XX° siècle) Partout s’effilochent les lambeaux de l’humanité » Même si La Cecilia, utopie d’une vie communautaire égalitaire- les aura un moment « recousus » (mais qu’est-ce un moment face à l’éternel ?) le « massacre des enfants/soldats » altère à jamais la conscience de Gabriel….
La localisation précise et imprécise à la fois (forêts villages fleuve, ville) les repères chronologiques disséminés ici et là, et les commentaires de photos albums dessins, rares témoins d’un passé proche ou lointain selon les points de vue et les époques-, vont mettre en exergue les répercussions des événements sur l’être humain afin qu’éclatent les dimensions à la fois historique et symbolique de la Crise…actuelle (début XXI°siècle). Crise qui concerne autant le climat que la politique et le social (la relégation des pauvres, discriminations). Et c’est la femme qui aimante maternelle courageuse tente de préserver la part d’humanité, face à ses ennemis prédateurs. Les figures féminines (Rebecca Alice Nour Clara), Hervé Le Corre les dote, dans leur évidente gémellité, de pouvoirs « divinatoires » au plus profond de leurs blessures et de leurs souvenirs (la récurrence de formules identiques d’une génération à l’autre le prouverait aisément) et leur pulsion de vie ne serait-elle pas la meilleure arme contre les « sales engeances » celles des chrétiens fondamentalistes et des islamistes qui après le chaos (génération de Rebecca) ont imposé un pouvoir religieux totalitaire, celles des hordes de sauvages pillant, saccageant
Voyez-les ces femmes manier habilement les armes, écoutez les préceptes qu’elles transmettent à leurs enfants….
Le choix de leurs prénoms (origine hébraïque latine arabe germanique) ne serait-il pas révélateur de la portée universelle que tente de donner l’auteur à son roman ? Nour et Clara par leur étymologie insisteraient sur la lumière ??
J’ai mis dans mon livre toute la hantise de ce que le XXIe siècle nous prépare»
« Le confinement, les rues vides, les camions frigorifiques à New York pour conserver les corps, l’effroi des premières semaines m’ont causé un choc. Je me demandais ce qui nous arrivait. »
La pandémie ? travailleuse imperturbable en son usine planétaire Le monde ? une décharge, une déliquescence
Qui après nous vivrez : Un roman en forme d’uppercut
-
« L’enfant dans le taxi » de Sylvain Prudhomme (éditions de Minuit)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Un roman tout entier tendu vers lui « l’enfant dans le taxi » qui sera désigné par la majuscule M ; un narrateur Simon tout entier tendu vers cet autre à découvrir par-delà les générations ; une écriture qui sait varier les points de vue, les déplis du sens, les temporalités, une écriture qui, enchâssant les récits, mêle enquête et quête de soi, dans ces révélations à valeur épiphanique, d’un secret, où scènes de l’intime côtoient la grande histoire. Tel se donne à lire ce nouveau roman de Sylvain Prudhomme avec ces clins d’œil au lecteur de « Là, avait dit Bahi ».
La scène d’ouverture est évoquée au présent, un présent censé immortaliser un amour sans entrave. Nous sommes en 1945 au lendemain de l’armistice, sur les bords du lac de Constance. Lui est un jeune soldat français ; elle, l’Allemande du lac. (elle nous sera plus familière quand nous aurons entendu certaines confessions comme autant d’aveux d’impuissance). Scène inaugurale, scène primitive, à valeur matricielle incontestée ; elle hante le narrateur qui se rappelle l’avoir déjà mentionnée dans un autre roman consacré au grand-père ; elle est pour lui l’équivalent de l’amour absolu ! Amour et naissance de M. Amour et naissance de l’écriture.
L’oncle Franz (un autre bâtard… à l’instar de M ? frère de M dans l’ordre des fils maudits) révèle lors de l’enterrement de Luciano Malusci l’existence d’un fils… Une révélation évoquée comme en temps réel -mais avec l’épaisseur du temps psychologique-, une révélation ressentie telle une déflagration intérieure, ce dont témoignent la disposition typographique et le recours à une phrase unique martelée de hoquets. (Ce procédé d’écriture aura son écho au chapitre 10 quand Louis « raconte » à Simon comment Malusci a refusé de voir son fils ce « bâtard » qui pourtant s’était déplacé en taxi... jetzt sind wir in frankreich lui avait dit le chauffeur !)
Un grand-père à peine enseveli dont on exhume un pan du passé inavoué, et ce au moment même où Simon vient de se séparer d’A la mère des deux enfants. (Or ilss’étaient aimés pour cette propension à aller de l’avant, portés par le besoin de croire). La dialectique ensevelir/exhumer va dès lors s’éployer dans l’investigation. En effet à partir du chapitre 3 (le roman en comporte 18) Simon est décidé à « faire toute la lumière » sur cet « enfant dans le taxi ». Se retrouver soudainement avec « le bout d’un fil entre les doigts, l’extrémité d’une pelote sur laquelle j’avais aussitôt senti que je n’aurais qu’à tirer pour faire venir à moi le reste de l’histoire ». Il sera le David Hemmings de Blow up (sauf que lui a surpris non la fin d’une vie mais le début).
Interroger les proches, essuyer leur refus (la grand-mère menace de bannir son petit-fils), leur silence (la mère « veut vivre dans le présent »), consulter internet, se rendre sur les lieux, ralentir, revenir, - en sens inverse de celui de M venu d’Allemagne en France à bord de ce taxi à la recherche du père-, bifurquer, faire marche arrière (dans cette impasse qu’emprunte Simon au volant de sa voiture en présence de ses deux fils, Tom et Victor, persuadé que M vit là…) explorer les « en dessous » (cf Georges Hyvernaud cité en exergue) faire un authentique travail de géologue. Une géologie de l’inconscient (celui du « refoulé « Commesi nous étions des glaciers ou des fleuves et que très loin au-dessous de la surface émergée de nos vies se poursuivait à chaque instant un travail invisible, provoquant de loin en loin des décrochages, des catastrophes, des crues que nous-mêmes constatons sans les avoir vues arriver avoue le romancier lors d’une interview). Simon l’homme délaissé et l’écrivain dont le désir d’écrire peut naître de « l’insatisfaction que les choses ne soient pas dites » va transformer l’absence de M en une authentique présence. Il se sent attiré par « cet esseulé majuscule qui avait connu l’abandon » il se sent le frère « dans l’ordre des condamnés au remodelage, à la fiction. Son frère dans l’ordre des intranquilles, des insatiables, des boiteux ».
Chronologique dans l’enquête, l’ordre linéaire se mêle aux fragments du passé revisité, -celui du grand-père en Algérie puis à Toulouse, par exemple, et à un passé plus récent, -celui de la vie commune avec A, le souvenir d’une balade avec les enfants sur la montagne des Cordes, la volonté de « tout » « mémoriser » dans un album dédié, ne correspond-elle pas à sa propre démarche : consacrer une pochette à M ? le rêve d’un M libéré s’adonnant aux plaisirs de la chair enjoignant Simon de les partager, cauchemar ou catharsis ? Et même lors d’une beuverie -fin de séminaire en Italie, quand alcool et lâcher prise l’enserrent dans les caresses de Veronika l’Allemande, la superposition de strates lui semble « inévitable », alors qu’elle tient peut-être du fantasme ? ou de la figure récurrente du ricochet ?
À l’enchevêtrement de temporalités correspond l’enchâssement des points de vue, des réminiscences, ou des « aveux » (ceux de Franz et de Louis en écho). La lettre écrite par M à Louis et Jacqueline pour les remercier de ces trois jours d’amour partagé « grâce à vous je me suis senti comme un fils » résonne telle une déchirure une cicatrice un cri d’espoir… Fi du bâtard ? cet être amputé ?
Au final l’apaisement du narrateur coïncide avec la reconquête de soi, qui est aussi apprivoisement de l’autre, cet oncle ballotté bafoué, mais que l’écriture aura sorti des limbes d’une mémoire… oublieuse.
Le roman s’ouvrait sur une échancrure bleutée, sur la rive allemande du lac de Constance celle où fut conçu le « secret » de famille !!! il se clôt sur cette même rive, où résonne un chant d’amour celui d’un enfant devenu grand-père !!!
-
"L'Amour" de François Bégaudeau (éditions Verticales)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Non François Bégaudeau ne signe pas « l’un des romans les plus condescendants de la rentrée ». Non le « sentiment amoureux n’est pas remplacé par de la sociologie de bas étage »(Nelly Kapriélian Les inrock).
Refuser la psychologisation, tout en ancrant le couple dans une réalité historique sociale identifiable, celle des années 1970 à 2020 (lectures loisirs travail mode de vie médias etc.) est-ce faire preuve de « condescendance » ? et l’apparent détachement de l’écriture (qui n’est pas écriture blanche) une écriture qui refuse l’analyse mais qui par la multitude de certains détails démontrerait que la vie amoureuse « est constamment tressée à la donnée matérielle » serait-ce mépriser la « classe dite moyenne » la considérer avec morgue ?
Si l’on s’en tient à la stricte focalisation, dans l’énonciation, rares sont les moments où le « narrateur » donne l’impression d’être omniscient, et regarder ses personnages comme en surplomb. La plupart du temps en effet le récit est traversé par le fameux discours indirect libre -où nous entendons comme dans un monologue intérieur, la voix de Jeanne ou de Jacques avec les marques de l’oralité (ce qui suppose d’ailleurs un travail sur l’écriture.
Et quoi qu’il en soit, la délicatesse des sentiments, de « l’amour » affleure souvent au détour d’un échange, d’une remarque sans passer par les mots attendus… Prenons pour exemplel’argumentation de Jeanne afin de dissuader Jacques de s’engager dans l’armée ; les raisons invoquées sont purement matérielles alors que le lecteur entend une déclaration d’amour ; quand le fils Daniel part en Corée le couple imagine la douleur d’une longue absence mais invoque des clichés -les Coréens n’ont pas de vacances ; quand Jacques vit dans la solitude d’après le deuil ce sont les voisins qui constatent hébétés combien il est « diminué » (par trop d’amour) et ses hallucinations visuelles vers la fin du roman ont le charme de ces amants chagalliens lévitant dans l’espace.
Que les « choses parlent d’elles-mêmes sans épaisseur réflexive »
« La première fois que Jeanne voit Pietro »étrange incipit ; clin d’œil à celui d’Aurélien roman d’Aragon ou à celui de l’Education sentimentale ? Le romancier entraînerait-il son lecteur dans le récit d’un coup de foudre ? d’un amour contrarié, d’un amour fou ? Réceptionniste dans un hôtel Jeanne est le témoin privilégié des « aventures » de Pietro et de… Mme Aubain ; or elle avait imaginé être sa compagne dans cettechambre 43, elle avait imaginé bâtir un avenir en commun (emploi du futur, recours à des clichés). Il n’en sera rien. Ce ne sera pas Pietro mais Jacques, sans coup de foudre, sans éclat. Le roman débute ainsi par « une fausse piste » et simultanément par le refus de cet engagement littéraire qui privilégierait l’évènementiel, le dramatique, le passionnel. Mais avant qu’en écho à la chambre 43 ne défilent les numéros des chambres 17, 34, 12, 23, 11, 27 (chambres réceptacles des « amours » Jeanne/Jacques), le romancier aura approché le quotidien de Jacques -en famille, au bistrot, au travail- alors que Jeanne aura dû se rendre à l’évidence…
Le travail du romancier sera de « rendre compte d’un amour ordinaire sur un demi-siècle, de façon concise (comme dans Un cœur simple ??) rendre compte d’un truc qui n’a pas de rupture, qui s’appelle « le temps».
Certes le texte est parcouru d’indications temporelles que le lecteur glane de ci de là au détour d’un paragraphe -celles consignées dans les agendas de la Redouteet quand Jeanne ne reçoit plus le catalogue, la simple mention « nulle part n’est écrit que… » (1997) le romancier va livrer une information comme s’il s’agissait d’une prétérition. Les autres « repères » sont volontairement évasifs (« un soir de… un mercredi de février, un vendredi de novembre un jour dont la date s’est perdue ») ou tout « simplement » les allusions à l’âge « bientôt 40 ans, ce n’est pas à 64 ans qu’il va apprendre à se reposer », à 17 ans il est temps qu’il (Daniel) gagne un peu d’intimité » « 35ans de mariage » « pour ses 43 ans » ! ou la référence à l’épisode 4334 de Plus belle la vie. Le passage du temps (dont l’angoisse du nouveau millénaire) est aussi lisible dans l’évolution des modes de vie, des goûts musicaux tout comme dans la routine assumée. (Et les exemples abonderaient, signalons la familiarisation quasi obligée avec l’informatique, d’abord source de chamaillerie puis d’addiction)
Se marier, fonder une famille, avoir une maison, « oser une relation extra-conjugale, « oser » se « mentir » (dans le mentir vrai), supporter les travers de l’autre (ronflement ou tics de langage ce dont rendent compte la reprise anaphorique du verbe « énerve » et la liste des griefs réciproques), s’engueuler gentiment (Félicie la marraine de Daniel s’amuse desduettistes). Quoi de plus banal ?
Mais écrire la banalité, la routine avec une certaine fluidité, éviter des « redites » (ce sera remplacé par les anaphores « on s’organise » « chaque année » ou le constat d’ailleurs lourd de sens selon le contexte, « on s’habitue »), éviter les pièges des découpages inscrits dans les « tranches de vie », tout en jouant avec des accélérations (cf les ellipses) ou des distensions (importance des préparatifs avant le mariage, les couacs et la soirée, visite inopinée de la « maîtresse », club vacances Congo, visite ultime de Frédéric) sans une once de tension qui se voudrait « dramatique », lui préférer la litote ou la suggestion (« quand Bill lèche les pieds nus de Jacques et ça ne le chatouille pas »), n’est-ce pas cette banalité qui par le tour de force de l’écriture serait exactement l’opposé de la condescendance ?
Jeanne et Jacques nos compagnons, Jeanne et Jacques un couple auquel le lecteur s’est attaché dans l’apprivoisement réciproque et l’absence de sidération.
« T’aurais pu être écrivain » affirme Aline jouant au scrabble, médusée par la richesse de vocabulaire de son amie « Peut-être mais pour raconter quoi ? rétorque dubitative l’intéressée, Jeanne (hiérarchie des thèmes dits « littéraires »? dissociation fond/forme ?)
« Raconter l’amour tel qu’il est vécu la plupart du temps par la plupart des gens : sans crise ni événement » n’est-ce pas le pari réussi de Bégaudeau dans ce roman où fond et forme sont en parfaite adéquation ?
-
« Bleu Bacon » de Yannick Haenel (éditions Stock Ma nuit au musée)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Bleu Baconou le récit d’une nuit passée à Beaubourg en 2019 (exposition Bacon en toutes lettres).
Bleu Bacon : un récit intérieur. Car la déambulation sera multiple : des fragments étoilés de souvenirs qui remontent à l’enfance (en Afrique) vont en surimpression se fondre dans des découvertes à valeur épiphanique par une immersion dans les tableaux du peintre, avant de transcender le tout en une philosophie de la vie, de l’existence qui lie étroitement, viscéralement, l’amour, l’acte de peindre et l’acte d’écrire. Bleu Bacon, un texte en 25 chapitres titrés, comme habité par la nécessité de faire éclater identité de regardeur de peintre d’écrivain avec la complicité du lecteur dans cette (re)conquête de la « volupté »
Investir les lieux équivaut à pénétrer dans le saint des saints ce dont témoigne le titre du premier chapitre « lesanctuaire »et les 8 salles sont comparées au labyrinthe des tombeaux égyptiens, 8 salles identiques et au milieu une galerie qui « les divisait comme dans un miroir » Or la « voix » (car l’expo met en connexion toiles et littérature, des œuvres chères au peintre dont des extraits sont lus par Mathieu Amalric, Hippolyte Girardot, Carlo Brandt JM Barr entre autres ) met mal à l’aise le « promeneur solitaire ». La voix, celle des Erinyes (Eschyle l’Orestie). Avant même de « voir » il est comme aveuglé, victime d’une « migraine ophtalmique ». Première étape douloureuse qui l’oblige à s’allonger sur le lit de camp. Le récit du « parcours » va associer presque musicalement rythme et révélations. Car ce livre Bleu Bacon ne saurait être exégèse ; il doit préciser une émotion, trouver des mots pour dire la béance que les tableaux de Bacon ouvrent en lui. Ainsi après la « pause » contrainte c’est le réveil avec ce bleu qui lui « gicle » au visage, le bleu du tableau Water from a Running Tap. Or « l’eau n’est-elle pas l’enfance du temps » ? et le bleu mène à son pays indemne (le flot « azurin cérulé prend figure d’oasis ») ; première béance « une faille qui s’ouvre en vous et vous accueille ». En se posant devant la sphinge, commencera «sa nuit avec Bacon » « Boire d’une seule gorgée » tous les tableaux, -ce dont rend compte l’époustouflant chapitre 6 composé d’une seule longue phrase qui épouse le rythme haletant de la course effrénée ; « le souffle se propulse d’une peinture à l’autre « alors que défilent comme en surimpression sur l’écran de la mémoire des images anciennes. Puis vers 1h du matin décidé à se poser devant chaque tableau il se sent « disponible à l’assaut immobile que Bacon renferme dans ses cages. Traversée flottante ; logique des rêves ». Entrer dans la peinture, sentir cette chair, éprouver la sensation de portes qui s’ouvrent avec l’inversion des réalités coutumières (quand le pied devient lèvre par exemple) .Nouveau langage à décrypter jusqu’à cette ultime étape où les détails comme extraits des tableaux vont vivre d’une vie indépendante ; quand sa lampe (Leroy Merlin) se fait lanterne magique et que par un geste immémorial Bacon s’inscrit sur les parois des grottes (Lascaux), que la peinture envahit tout l’espace, qu’elle est devenue air, respiration dans cette volupté (re)conquise (cf l’exergue « la volupté c’est tout ce que nous voulons » Bacon)
Non Bacon n’est pas ce peintre de la violence et de la cruauté comme on a tendance à le définir avec complaisance. Yannick Haenel dit simplement dans la clarté de l’évidence « c’est la société qui est sadique (et qui a intérêt à nous faire croire que les artistes sont des détraqués). Un grand peintre, comme Le Caravage ou Bacon, n’est ni du côté du mal ni contre le mal : c’est quelqu’un qui s’empare de la violence dont les humains sont l’objet pour lui donner une forme qui la dénude. Le monde est abject, sauvage, criminel ; un peintre en restitue l’énigme nerveuse. »
Le lecteur que le romancier prend régulièrement à partie (en le vouvoyant à moins que l’instance narrative ne soit un procédé…) est « embarqué » dans ce « voyage ». Le lit de camp ? Une barque qui au tout début le transporte aux confins d’une mémoire (désert du Ténéré, dans le nord du Niger, Niamey les falaises de Bandiagara, au Mali, et le Renard pâle, et le dieu dogon, Et un sorcier qui s’avance vers l’adolescent).
Une des ambitions affichée(s) n’est-elle pas deDonner à voir au lecteur la peinture de Bacon par des mots ? Décliner toutes les nuances de bleu, ouvrir des portes, se glisser dans le miroitement des reflets, vaciller dans la lumière (écriture des éclairs) plutôt que d’entrer dans un tableau, suivre une auréole bleue avant le grand rendez-vous avec les triptyques à la mémoire de George Dyer (dont un où le rose dit la noirceur du tragique suicide et de la culpabilité qui habite le peintre) Et ce zoom sur le pied d’Œdipe ? sur cet anneau de crème rose qui s’échappe d’un jet d’eau ? sur cette déferlante du Jet d’eau ?« Et plus puissante qu’une inondation, une chose que rien ne peut canaliser parce que le désir, en elle, est inextinguible : le sexe »
On croit qu’on regarde la peinture, mais c’est soi-même qu’on scrute éperdument.
- replica hublot big bang
- replica rolex
- rolex replica
- richard mille replica watches
- replica richard mille
- fake richard mille
- richard mille replica
- replica richard mille watches
- richard mille replica watches uk
- richard mille replica
- replica richard mille watches uk
- fake richard mille watches
- luxury richard mille replica watches
- swiss replica richard mille watches
- réplicas de relojes Rolex
- réplicas de relojes
- réplicas de relojes cartier
- réplicas relojes
- replica uhren
- rolex replica uhren
- luxus replica uhren
- répliques de montres rolex
- réplicas de relojes rolex
- fake rolex
- schweizer replica uhren
- gefälschte rolex uhren
- replica rolex uhren
- beste replica uhren
- replica rolex uhren
- rolex replica horloges
- replica horloges
- panerai replica horloges
- luxe replica horloges
- orologi replica panerai
- orologi replica rolex
- falso rolex submariner
- rolex replica watches
- replica watches uk
- patek philippe replica watches
- swiss replica watches
- replica watches
- rolex replica
- fake rolex watches
- luxury replica watches
- super clone watches
- répliques de montres rolex
- répliques de montres patek philippe
- fausses montres rolex datejust
- rolex replique montres
- répliques de montres rolex
- fausses montres rolex
- meilleure répliques de montres
- répliques de montres pour hommes et femmes
- boutique de répliques de montres
- répliques de montres
- répliques de montres suisses
- répliques de montres audemars piguet
- répliques de montres hublot
- répliques de montres rolex
- replica horloges
- réplicas de relógios
- cheap replica watches uk
- rolex replica watches uk
- fake rolex
- rolex replica watches
- Patek Philippe replica watches
- replica rolex watches
- swiss replica rolex watches uk
- hublot replica watches
- replica watches uk
- swiss replica watches
- replica watches
- Audemars Piguet replica watches
- rolex replica watches uk
- fake rolex watches
- rolex replica watches
- replica watches uk
- replica watches uk
- swiss replica watches
- replica watches
- luxury replica watches uk
- cartier replica watches
- Swiss replica watches
- replica watches
- omega replica watches
- replica watches uk
- luxury replica watches
- cheap fake rolex
- replica watches uk
- audemars piguet replica orologi
- orologi replica panerai
- migliori orologi rolex replica
- migliori orologi replica
- orologi replica rolex per uomo
- orologi rolex replica
- orologi rolex replica svizzeri economici
- orologi Rolex falsi economici
- orologi svizzeri replica Omega
- orologi omega replica svizzeri
- falso rolex sea-dweller
- orologi rolex replica di lusso
- svizzeri falso rolex
- falsi rolex submariner
- rolex replica horloges
- nep rolex horloges
- zwitserse replica horloges
- replica horloges nederland
- rolex replica horloges
- luxe replica horloges
- rolex replica horloges
- replica horloges nederland
- panerai replica horloges
- replica horloges winkel
- replica breitling horloges
- replica horloges
- omega replica watches
- omega replica watches
- swiss replica watches
- replica watches
- replica rolex watches
- patek philippe replica watches
- swiss replica watches
- répliques de montres Rolex
- réplicas de relojes Rolex
- rolex falsos baratos
- réplicas de relojes suizos
- réplicas de relojes para hombres
- mejores réplicas de relojes
- réplicas de relojes
- rolex replica uhren
- replica uhren
- breitling replica uhren
- schweizer replica uhren
- replica rolex uhren
- beste replica uhren
- replica uhren für herren
- omega replica uhren
- replica uhren für damen
- omega speedmaster replica uhren
- fake rolex submariner
- rolex replica uhren
- luxus replica uhren
- rolex day-date replica uhren
- replica uhren
- replica watches
- replica watches uk
- luxury replica watches
- swiss replica watches
- rolex replica watches
- replica rolex
- super clone watches
- fake rolex
- replica watches
- replica watches uk
- luxury replica watches
- swiss replica watches
- replica watches
- replica watches uk
- fake watches
- replica watches
- richard mille replica watches
- replica watches uk
- rolex repliky hodinek
- švýcarské repliky hodinek
- falešné rolex
- repliky hodinek v ČR
- falešné hodinky rolex
- švýcarské repliky hodinek rolex
- repliky hodinek rolex
- repliky rolex
- repliky hodinek omega
- falešné rolex datejust
- repliky hodinek breitling
- luxusní repliky hodinek
- repliky luxusních hodinek
- repliky hodinek rolex v Praze
- levné falešné hodinky rolex
©2003 - 2012 Art-Culture-France - Tous droits réservés Mentions légales | Partenaires & Publicités | Plan du site | Contact | www.mairie.com













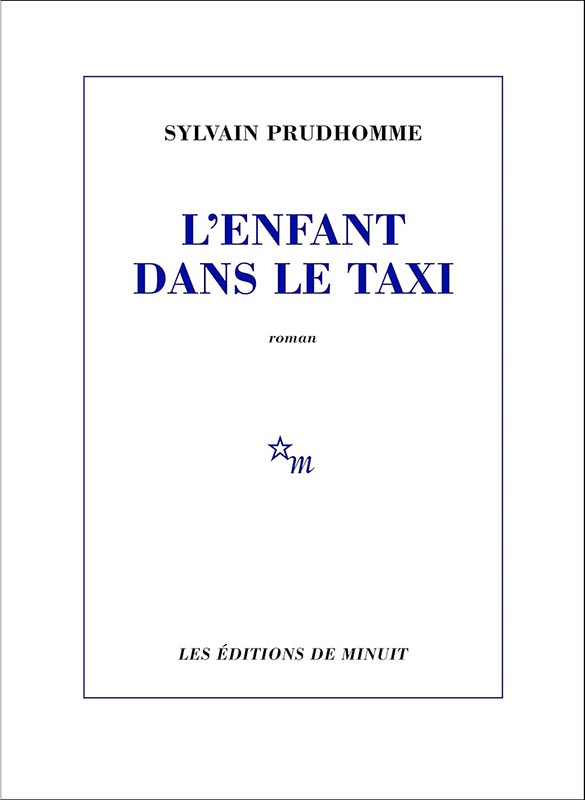

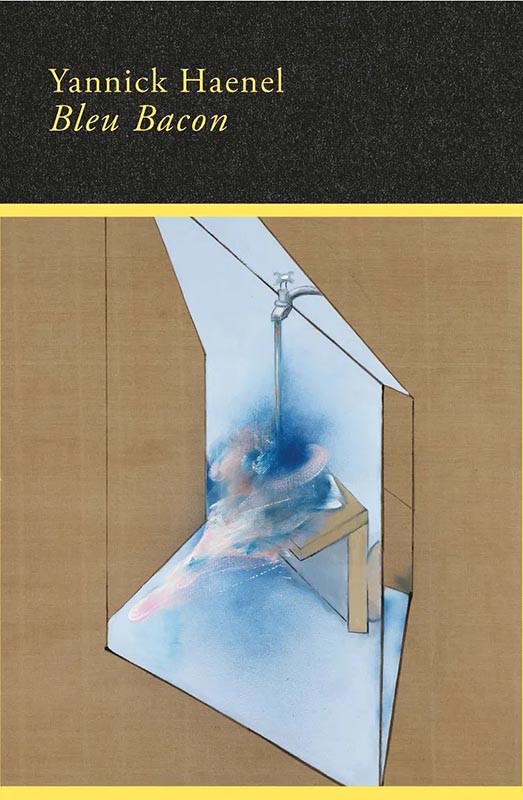
![[Alternative text]](images/pubs/galerie_acf.jpg)