Littérature
Critiques littéraires
-
« Bleu Bacon » de Yannick Haenel (éditions Stock Ma nuit au musée)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Bleu Baconou le récit d’une nuit passée à Beaubourg en 2019 (exposition Bacon en toutes lettres).
Bleu Bacon : un récit intérieur. Car la déambulation sera multiple : des fragments étoilés de souvenirs qui remontent à l’enfance (en Afrique) vont en surimpression se fondre dans des découvertes à valeur épiphanique par une immersion dans les tableaux du peintre, avant de transcender le tout en une philosophie de la vie, de l’existence qui lie étroitement, viscéralement, l’amour, l’acte de peindre et l’acte d’écrire. Bleu Bacon, un texte en 25 chapitres titrés, comme habité par la nécessité de faire éclater identité de regardeur de peintre d’écrivain avec la complicité du lecteur dans cette (re)conquête de la « volupté »
Investir les lieux équivaut à pénétrer dans le saint des saints ce dont témoigne le titre du premier chapitre « lesanctuaire »et les 8 salles sont comparées au labyrinthe des tombeaux égyptiens, 8 salles identiques et au milieu une galerie qui « les divisait comme dans un miroir » Or la « voix » (car l’expo met en connexion toiles et littérature, des œuvres chères au peintre dont des extraits sont lus par Mathieu Amalric, Hippolyte Girardot, Carlo Brandt JM Barr entre autres ) met mal à l’aise le « promeneur solitaire ». La voix, celle des Erinyes (Eschyle l’Orestie). Avant même de « voir » il est comme aveuglé, victime d’une « migraine ophtalmique ». Première étape douloureuse qui l’oblige à s’allonger sur le lit de camp. Le récit du « parcours » va associer presque musicalement rythme et révélations. Car ce livre Bleu Bacon ne saurait être exégèse ; il doit préciser une émotion, trouver des mots pour dire la béance que les tableaux de Bacon ouvrent en lui. Ainsi après la « pause » contrainte c’est le réveil avec ce bleu qui lui « gicle » au visage, le bleu du tableau Water from a Running Tap. Or « l’eau n’est-elle pas l’enfance du temps » ? et le bleu mène à son pays indemne (le flot « azurin cérulé prend figure d’oasis ») ; première béance « une faille qui s’ouvre en vous et vous accueille ». En se posant devant la sphinge, commencera «sa nuit avec Bacon » « Boire d’une seule gorgée » tous les tableaux, -ce dont rend compte l’époustouflant chapitre 6 composé d’une seule longue phrase qui épouse le rythme haletant de la course effrénée ; « le souffle se propulse d’une peinture à l’autre « alors que défilent comme en surimpression sur l’écran de la mémoire des images anciennes. Puis vers 1h du matin décidé à se poser devant chaque tableau il se sent « disponible à l’assaut immobile que Bacon renferme dans ses cages. Traversée flottante ; logique des rêves ». Entrer dans la peinture, sentir cette chair, éprouver la sensation de portes qui s’ouvrent avec l’inversion des réalités coutumières (quand le pied devient lèvre par exemple) .Nouveau langage à décrypter jusqu’à cette ultime étape où les détails comme extraits des tableaux vont vivre d’une vie indépendante ; quand sa lampe (Leroy Merlin) se fait lanterne magique et que par un geste immémorial Bacon s’inscrit sur les parois des grottes (Lascaux), que la peinture envahit tout l’espace, qu’elle est devenue air, respiration dans cette volupté (re)conquise (cf l’exergue « la volupté c’est tout ce que nous voulons » Bacon)
Non Bacon n’est pas ce peintre de la violence et de la cruauté comme on a tendance à le définir avec complaisance. Yannick Haenel dit simplement dans la clarté de l’évidence « c’est la société qui est sadique (et qui a intérêt à nous faire croire que les artistes sont des détraqués). Un grand peintre, comme Le Caravage ou Bacon, n’est ni du côté du mal ni contre le mal : c’est quelqu’un qui s’empare de la violence dont les humains sont l’objet pour lui donner une forme qui la dénude. Le monde est abject, sauvage, criminel ; un peintre en restitue l’énigme nerveuse. »
Le lecteur que le romancier prend régulièrement à partie (en le vouvoyant à moins que l’instance narrative ne soit un procédé…) est « embarqué » dans ce « voyage ». Le lit de camp ? Une barque qui au tout début le transporte aux confins d’une mémoire (désert du Ténéré, dans le nord du Niger, Niamey les falaises de Bandiagara, au Mali, et le Renard pâle, et le dieu dogon, Et un sorcier qui s’avance vers l’adolescent).
Une des ambitions affichée(s) n’est-elle pas deDonner à voir au lecteur la peinture de Bacon par des mots ? Décliner toutes les nuances de bleu, ouvrir des portes, se glisser dans le miroitement des reflets, vaciller dans la lumière (écriture des éclairs) plutôt que d’entrer dans un tableau, suivre une auréole bleue avant le grand rendez-vous avec les triptyques à la mémoire de George Dyer (dont un où le rose dit la noirceur du tragique suicide et de la culpabilité qui habite le peintre) Et ce zoom sur le pied d’Œdipe ? sur cet anneau de crème rose qui s’échappe d’un jet d’eau ? sur cette déferlante du Jet d’eau ?« Et plus puissante qu’une inondation, une chose que rien ne peut canaliser parce que le désir, en elle, est inextinguible : le sexe »
On croit qu’on regarde la peinture, mais c’est soi-même qu’on scrute éperdument.
-
« Vivre dans le feu » d’Antoine Volodine (éditions Seuil)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Dernier ouvrage signé Antoine Volodine, mais antépénultième de « l’édifice post-exotique » Vivre dans le feu serait un guide de survie, les leçons du feu au cœur du brasier. Le jeune soldat Sam va être emporté par une vague de napalm. Pour un ultime « pétillement d’agonie », il compose un « Petit roman hurlé en accéléré ». Roman que le lecteur feuillette en même temps qu’il est censé s’écrire, se « vivre ? Ou roman prequel ? Roman d’initiation sur le mode onirique ? peu importe ! la réponse à l’instar de la question est multiple, et s’évanouit dans l’abolition -ou la vacuité- même de son énoncé. L’essentiel n’est-il pas « d’Inventer la famille du feu, l’aimer jusqu’à la fin, rester fidèle au clan du feu en se vêtant du manteau du feu comme si de rien n’était » ?
Laissons-nous emporter par les songes et les pérégrinations de Sam (double de Mevlido ?) dans un « nouvel » espace-temps où tous les repères sont abolis, où la voix est déformée (comme dans le Bardo ?)
Tout prendre à rebrousse-poil : le temps suspendu, l’auto-dérision, la mise en abyme, et ce, pour une seconde d’éternité. A l’instant où Sam va mourir voici que « sa » famille, surtout des femmes -grand-mères tantes cousines -se manifeste, prend vie sur l’écran de la mémoire, de l’imagination, des rêves. Les deux grand-mères Rebecca et Wolfong encadrent le roman, vieillardes roublardes plus que centenaires, dépositaires l’une du texte « vivre avec le feu » l’autre de sa pratique consommée -et bientôt consumée ?
Si Antoine Volodine consacre à chaque membre de la famille un chapitre -tel un court métrage avec sa dynamique interne ses décors spécifiques sa tonalité particulière- c’est que chacun a « dispensé » une « leçon de feu » -théorique et/ou pratique, et que dans le monde onirique de Sam, -qui se confond avec le monde et le mode narratif(s)- chacun est comme un archétype (la cantatrice et son chant diphonique, la chamane sorcière)- ce dont témoigne la diversité de traitement musical et formel (dialogues et récit, vocables gutturaux, réalisme cru et envolées plus poétiques, tableautin instantané flash ou plus ample développement, dramatisation et/ou contemplation. Le long chapitre « chov mokrun alnaoblag » mériterait à lui seul un commentaire particulier, car il allie avec élégance les « motifs » narratif, dramatique, cinématographique et idéologique. Chapitre pivot de l’initiation (pour Sam), et simultanément auto textualité (pour l’auteur) et intertextualité (pour le lecteur de « Terminus radieux, Black village, Bardo »)
Une narration éclatée qui illustrerait des dysfonctionnements internes au clan, voire des haines et des assassinats ciblés ? (cf l’homoncule du grand-père Bödgröm tué par Sam à la demande expresse de tante Yoanna; alors que tante Zam a évité le tir mortel de sa fille sniper grâce à une imprécation). En fait, la fragmentation n’est qu’apparente car d’un chapitre à l’autre se répondent des « motifs » tels des échos intérieurs (l’oxymore « flammes noires » la « noirceur absolue du feu », le personnage sujet d’un chapitre mais objet de mire ou de ressentiment dans un autre, les imprécations la sorcellerie) ou des contrastes en échos inversés (à la longue chevauchée avec les tantes Coltrane et Sogone dans l’univers macabre charbonneux de l’après-apocalypse répond celle en compagnie des deux cousines Madonna et Silsie sur un territoire mongol aux béances vertes et lumineuses)
Comme la plupart des personnages post exotiques Sam lutte pour sa « survie ». Certes il a été victime d’un long coma (des années ? des siècles ? dans le monde onirique ou bardique les repères temporels sont abolis) Une si longue absence ! Retiré « d’un brasier au milieu d’une ville où tout flambait, » il n’a pas connu les grands bouleversements, lui qui en sous-sols était choyé par des moinesses - leurs noms enchanteurs sont les témoins de cette existence antérieure…Grand-mère Padayara tente en vain d’extirper quelque bribe de ce « voyage immobile » mais l’aveu « je ne voyais rien et je le regrettais » tendrait à prouver qu’il n’y a pas eu Re-naissance. Et que la lutte pour la survie en cet instant si précieux -où il s’invente… une Vie- serait la manifestation d’une aptitude quasi viscérale à survivre, dans cette entièreté que lui confère l’auteur Volodine.
A l’instar de Sam spectateur halluciné d’une « réalité parallèle chargée de passé bizarre et de poésie » qu’il voit défiler sur l’écran dans cette salle de projection de Newtown (ex Goumkhad) en compagnie de tante Sogone, le lecteur/spectateur n’a-t-il pas assisté à une aventure où se mêlent le tragique le cauchemar la douce sensualité et l’humour pince sans rire ? alors que simultanément sur l’écran de sa mémoire défilaient personnages et univers lointains et si proches…
« Début de la fin »
« Je dispose d’une seconde / J’ai donc tout mon temps »
En écho l’excipit
« J’avais encore une grosse seconde devant moi / Ça me laissait de la marge pour voir venir »
Et pour le lecteur, entendre bientôt une autre voix du post-exotisme ?
-
« Blizzard » de Marie Vingtras (Editions de l’Olivier 2021 - Editions Points 2023)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Prix des libraires 2022
Un jour de blizzard en Alaska ! Pour « refaire » ses lacets Bess a lâché la main du petit, et elle l’a perdu… Mais pourquoi est-elle sortie un jour de tempête ? Vivre ici est déjà si difficile quand il n’y a pas de neige… Et le gamin est-il encore en vie ?
Suspense et suspens ! L’autrice, dont c’est le premier roman, marie les deux avec élégance. En effet, c’est par bribes que Marie Vingtras livre les éléments informatifs, et si la recherche de l’enfant impose le rythme d’une course contre la « mort », ce « motif » à la fois narratif et dramatique va se confondre progressivement avec la quête de soi. Choral, en apparence seulement, le roman fait se succéder en alternance quatre monologues intérieurs, ceux d’une femme et de trois hommes… Le lecteur comprendra la Vérité de ce qui les (re)lie, vérité qu’un linceul cotonneux avait drapée. Un drapé que des indices telles des trouées lumineuses avaient perforé dans l’évidence de la nudité. Le titre se parant a posteriori d’une autre signification qui inclut autant le lecteur que chacun des personnages (vivants morts fantômes).
Quatre monologues - les voix de Bess, Benedict Cole et Freeman- se succèdent dans une unité de temps (une journée) de lieu (un coin d’un pays perdu) et d’action (la recherche du gamin). Benedict, un local, habitué au grand froid, « l’homme des bois pistant chassant » sait que dans ce pays tout est engourdi l’hiver et s’emballe dans l’urgence l’été ; Pays perdu où vous oubliez jusqu’à ce que vous étiez avant ; pays d’hommes si rude que très peu de femmes ont envie d’y survivre et pourtant Bess la fille de Californie rousse à la peau dorée ébréchée comme une tasse de porcelaine et dont le blizzard est l’écho désordonné de son propre cœur avait accepté de le suivre... Dans sa recherche, Benedict est accompagné par Cole un vieil ivrogne célibataire, qu’il connaît depuis toujours. Quant à Freeman, le seul Noir, qui ignore tout des pérégrinations glacées de ses voisins, il se remémore son passéde militaire. Nous allons nous familiariser avec leurs motivations, leur « histoire », avec la façon dont l’un perçoit l’autre ainsi qu’avec les fantômes qui les hantent. Bien plus le même événement peut être rapporté selon deux points de vue différents (ex la rencontre Bess Benedict). Les monologues, d’abord très courts dans l’instantanéité de l’urgence, vont se lester du « poids » des souvenirs à mesure que la mémoire non oublieuse ressuscite des pans du passé proche ou lointain. Un absent Thomas le frère de Benedict disparu (à jamais ?) mais qui impose une présence torturante, alors que Clifford le pote de Cole est comme une ombre maléfique !!
On aurait aimé qu’à chaque protagoniste corresponde une écriture particulière, tout simplement parce que chacun semble incarner un archétype (même si tous sont habités par la « culpabilité », laquelle reste protéiforme). Or, si Bess s’exprime de façon « savamment » désordonnée - martelant des soubresauts qui affluent par hoquets-, si les monologues de Cole frappent par une trivialité foncière -en harmonie d’ailleurs avec le sexisme le racisme et l’alcoolisme du personnage, les voix de Benedict et de Freeman sont plus « lisses » (entendons classiques) quand bien même les deux sont des êtres tourmentés. Mais l’essentiel est bien sûr la structure d’ensemble, celle d’une mosaïque. N’illustre-t-elle pas les propos de Benedict Nous formions une mosaïque compacte que chaque individu venait parfaire sans que personne puisse contempler le résultat dans sa globalité ? Bien plusl’éclatement des points de vue épouse l’émiettement de leurs vies. Un émiettement au service de la dialectique effacement/révélation. A l’instar de ces tourbillons neigeux, de ces enfouissements avant les ultimes prises de conscience (consécutives pour certains à des « forfaits ») tout comme vers la fin du roman des éclaircies vont colorer le ciel « d’éclats bleu roi » (surtout ne pas spoiler car le suspense inscrit dans la construction d’ensemble, serait frappé d’inanité).
Une seule voix féminine ! Et pourtant Bess (Elizabeth Morgensen) a un rôle capital. En portant la responsabilité de la perte de l’enfant, elle oblige les autres à réagir et à révéler leur être profond. Elle-même au lieu de se fondre dans le moule de la « femme mariée, rangée classe moyenne américaine » avait préféré l’errance, les « petits boulots » en dysharmonie totale avec le fameux « rêve américain ». Ecoutons cette femme qui a bravé le virilisme inscrit dans la « conquête de l’Ouest »J’ai provoqué des types dans les bars où je travaillais comme serveuse, des types qui auraient pu m’allonger d’un coup de poing. […] Souvent, ça les arrêtait, ils ne s’attendaient pas à ce que je recherche cette violence. Ce n’est pas si fréquent chez une femme et c’est perturbant pour un mâle dominant ». Timbrée givrée pas deux sous de jugeote une folle c’est ainsi qu’elle est perçue par Cole et Clifford (autant dire par ceux qui refusent toute forme d’altérité)
C’est elle qui découvre le « fameux carnet » ; le déclencheur… avouera Benedict…
Un carnet à valeur métonymique. Un carnet « mise en abyme » ?
Des ambiances à la Fargo, des voyages dans le temps comme autant de périples qui transportent le lecteur de l’Alaska à la Californie, à New York (et sa puissance tentaculaire) ou au Vietnam (champ des pires horreurs). Chaque personnage portant les stigmates de ces lambeaux arrachés au temps et à l’espace !
On comprend que ce premier roman ait été couronné de multiples prix (cf la liste en quatrième de couverture)
-
« Le temps est une mère, poèmes » de Ocean Vuong (éditions Gallimard)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Comme le rappelle avec pertinence Alain Roussel, la prose, linéaire, qui ne revient à la ligne que par la contrainte physique de la page, avec ses points et ses virgules, est une manière d’articuler la pensée ; le poème lui se positionne autrement verticalement ; au bout de chaque vers il y a du silence qui porte en virtualité ce qui n’est pas dit, d’où une force suggestive qui décuple l’émotion » Le temps va tomber dans l’espace en cascade. Et dans cette « chute » il peut retenir en suspens les « origines ; ce que suggère le titre du recueil « le temps est une mère » d’Ocean Vuong, poète de 34 ans né au Vietnam et vivant aux USA. D’autant qu’il s’agit moins d’apprendre à habiter le monde que le temps ; et ce sera par l’hommage à la mère disparue -celle que l’écriture fait advenir et qui prend Vie.
Composé de quatre parties distinctes ce recueil au titre allégorique et charnel à la fois, n’en est pas moins traversé par des échos intérieurs, ces effets spéculaires qui jouent avec le prisme du temps. D’une partie à l’autre certains poèmes se donnent à lire telles des missives Cher Peter, Chère Sara, Cher T, Chère Rose et si chaque partie semble correspondre à une étape particulière de l’existence, la convocation de « fantômes » tout comme cette surimpression présent/passé irriguent l’ensemble dans Un temps retrouvé.
D’emblée se visualise la diversité des « possibles » qu’offre la poésie : coupes du vers au milieu d’une phrase, ruptures syntaxiques ou au contraire longueurs presque inhabituelles, disposition en blocs tels des paragraphes, un micro récit, ou au contraire répartition en distiques ; bien plus certains poèmes ressemblent étrangement à des calligrammes (dans les « maraudeurs » par exemple, la disposition typographique semble épouser la sinuosité et la reptation des poissons). Preuve de l’inventivité du poète : une variété formelle qui d’ailleurs va de pair avec la variété des « niveaux de langue », avec toutefois un bémol : la présence quasi abusive del’esperluette &… Volonté de lier étroitement inscription typographique du texte dans la page et quête d’un temps « perdu » ( ?) - tout en sachant que le lecteur sera guidé plus par le rythme que par le mètre.
Les aspects autobiographiques sont bien présents, dans la clarté de l’évidence et colorent d’un certain lyrisme l’écriture : la relation au père (légende américaine donne à voir les corps entrechoqués lors d’un accident de voiture, alors que père et fils se rendaient à la clinique pour faire piquer la chienne Susan), l’oncle,Parce que mon oncle a décidé́ de quitter ce monde, intact ; l’homosexualité affichée et assumée (dernière reine du bal de l’Anrtarcique « peut-être… ai-je vu un garçon… & su que je ne serais jamais hétéro) ; le souvenir de la guerre Vietnam (napalm au sillage arc-en-ciel les miens si immobiles sur les photos en cadavres ; des allusions à Auschwitz (rien, comme en surimpression un fantôme apparaît en filigrane sur une recette de cuisine, déneiger faire du pain). Interrogation aussi (et bien évidemment) sur la culture américaine par celui qui vit loin de son pays d’origine depuis l’âge de deux ans. Culture et langage. Culture et société. Culture et idéologie. En évoquant le cas de Jaxson « tombé dans les pommes après sa mastectomie / J’arrive pas à croire que j’ai perdu mes nichons, disait-il l’instant d’avant, souriant entre ses larmes / […] Parce que retirer à mon ami un morceau de lui le rend plus entier » c’est le problème de la transidentité qui est soulevé ; la violence des relations, l’opprobre jeté par la « communauté prétendue bien-pensante » mais si profondément homophobe. Parce que lorsqu’un homme & un homme / entrent main dans la main dans un bar / la blague se retourne contre nous Àla broche, le pédé ». Et quand cette homophobie se conjugue au racisme anti asiatique, la victime est doublement stigmatisée t’es asiate ou t’es normal ? / […] appelle-moi / pédale / j’ai besoin de toi / va te faire foutre ».
Le poète est habité par le chagrin lié à la disparition des êtres chers et en premier à celle de la mère La mort de Rose (en 2019) est évoquée sans le pathos attendu Rose, ai-je chuchoté pendant qu’ils enfermaient ma mère dans son sac mortuaire, sors de là / Tes plantes sont en train de mourir / Ça suffit comme ça. (Long poème Même pas en II). Mère dont l’historique d’achats sur Amazon, sous forme de poème inventaire, rend compte de mars à novembre -soit durant 20 mois- de l’évolution de la maladie, jusqu’à cette « urne en aluminium plaque commémorative customisée Ou dans « des raisons de rester » en III vers la fin « ma mère devant son miroir qui se met du rouge aux joues avant d’aller en chimio. Et surtout la longue missive « chère Rose » (en IV) Roland Barthes en épigraphe. Hong qui signifie rose, rose hong mère Si tu lis ces mots alors tu as survécu/à ta vie dans celle-ci » et en écho« si tu lis ces mots alors / j’ai survécu à ma vie dans la tienne ; toi la blanche /petite diablesse fantôme affamé.
Le gouffre laissé par la disparition de cette mère Ocean Vuong le comble précisément par cette « écriture rétrospective » dont le très long poème Künstlerroman qui ouvre la 3ème partie en serait l’illustration. Poème que scande la reprise anaphorique de « la cassette saute » et « à reculons ». Et voici qu’au ralenti défile son passé en chronologie inversée (à reculons) avec des temps forts (un processus qui n’est pas sans rappeler la poétique du ressouvenir chez Apollinaire : « Les vergers fleuris se figeaient en arrière ») ; les drogues quittent les veines de quatre amis dans la Mazda et ce lycéen scotché à l’écran pour un rendez-vous avec un gay ; même la tour nord de New-York se reconstruit ; le blizzard accompagne l’anniversaire de ses 7 ans.
Et simultanément nous assistons à la « naissance de l’écriture » dans sa matérialité (des livres se désintègrent en arbres) et la transmutation quasi alchimique qu’elle est capable d’opérerLes souvenirs ? des traces sur la neige, Lesmots ? Des frissons dans les arbres »
Le temps ? Une mère
Une mère à laquelle Ocean Vuong dédie son recueil
A ma mère, Lê Kim Hong, appelée de l’avant
-
« Le chien des étoiles » de Dimitri Rouchon-Borie (éditions Le tripode)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Aidé d’un rapace nocturne, la chouette effraie, réconforté par la présence d’un chien, Gio le géant cabossé -depuis qu’il a « pris un tournevis dans le crâne- est le héros de ce deuxième roman de Dimitri Rouchon-Borie. Lui et les
deux gamins- Papillon, enfant muet dont les gestes en ailes déployées seront un syllabaire- et Dolorès -cette proie de toutes les concupiscences adultes. Enfants que la voix de la nuit lui a enjoint de protéger
Ecoutons dans une langue aussi cabossée que la meurtrissure inaugurale mais aussi poétique que les fils d’une lévitation vers les étoiles, leur odyssée, celle qui affleure dans le choix des différents titres depuis « comme on se retrouve » jusque« comme on recommence ».
Gio est de retour chez les siens. Après des mois passés à l’hôpital. Retour de l’enfant prodigue ? retour du royaume des morts ? En tout cas sur le crâne (ciboulot dévissé pour toujours affirme péremptoire le père dès le début) une cicatrice, qui, en présence des dangers, vibrera telle une antenne !! une cicatrice « boussole ». Dès ce premier mouvement « Comme on se retrouve » nous pénétrons dans un univers « à la marge » fait de violence, de vendetta, de mœurs primitives, d’entraide aussi avec les figures du père, de la mère, des oncles, une communauté de gitans, d’hommes libres (uriner c’est arroser où on veut). Lui Gio qui rêve d’aller aux étoiles par les courants d’air, découvre cette chouette « sabre couleur de lune qui s’abat sans bruit sur la terre, beauté fatale », de même qu’il sera le seul à comprendre et traduire les gestes du jeune enfant muet… Ce premier mouvement telle l’ouverture d’une symphonie, contient en un saisissant raccourci tous les thèmes qui iront s’amplifiant s’analysant s’illustrant (dont la bonté foncière des trois « cabossés » et la folie meurtrière de certains hommes, le mélange de prosaïsme et de poésie, et la présence tutélaire de la statuette de la Vierge Noire, sainte vénérée par les gitans). Suite à l’épisode de la vengeance - Gio en refusant d’y participer a contribué malgré lui à l’hécatombe- c’est le grand départ « Comme on s’échappe » loin du charnier vengeur et « les yeux dans le dos à cause des autres sur leur trace. Les voici tous les trois grimpant dans un train de marchandises ; dans un wagon où l’incongruité d’un passager vagabond Blizzard tournera à la tragédie. Errance de trois âmes déjà saturées par un trop plein de misères (le récit sur les origines, le parcours de Papillon est assez révélateur) et dont la bonté foncière ne pourra vaincre la méchanceté des hommes ! Puis ce sera la « pause » dans la ville, quartier Est (comme on se pose) ; trop occupé par les activités « imposées » Gio aura manqué de vigilance ? Au sortir de cette douloureuse expérience, il est métamorphosé (comme on naît), exilé dans un autre monde, devenu le fou hurlant, une légende des transcontinentaux, le fantôme des rails… Mais Ses yeux d’enfant fabriquent de l’eau sans se lasser. Ses implorations seront entendues par un vieux coach, cubain. Une ellipse (apparente) sur le destin des deux enfants après la « pause » dans la ville, sera comblée par le récit rétrospectif que fait Gio au chien Camarade. Et c’est précisément pour les « rejoindre » dans les étoiles avec ce chien de (in)fortune (le chien éponyme du titre) que Gio dans la cabane (double de celle du tout début du roman ?) reproduit de mémoire le dessin esquissé par Papillon et le parachève. Une immense fresque sur les murs fraîchement peints en blanc par le propriétaire cubain Henrique, le coach bienveillant, une fresque comme la mise en abyme de tout le roman. C’est avec ardeur que Gio s’y adonne ; une ardeur que les habitants voisins interprètent -avec une mauvaise foi éhontée, sous l’égide de Suzy- comme la marque du Diable. Le sort en est scellé. Abominable justice immanente ! L’envol (dans l’avant-dernier chapitre) est restitué en italique (comme si ce passage -ultime lévitation- était hors récit : paratexte ? épigraphe ? épitaphe ?
Comme tous les récits de « voyage » le périple de Gio et de ses deux compagnons est jalonné par des étapes, est censé se nourrir de rencontres (et les personnages dits secondaires se parent de la dimension de la singularité, car ils sont ciselés telles des eaux-fortes qui en accentuent d’ailleurs les traits malfaisants Blizzard, la Grand-Mère, Fézir Micek, Isaac, Suzy, hormis Henrique) et partant le « récit » souvent se convertit en voyage initiatique. Hormis que « le chien des étoiles » est constamment ballotté entre deux forces contradictoires (à l’instar de l’être humain comme le rappelle la Grand-Mère à Dolorès « un jour tu t’envoles un jour tu chutes on a les pattes au sol et la tête au ciel c’est comme ça qu’on est fait ? et dont rendrait compte la langue de Dimitri Rouchon-Borie à la fois « noire et poétique » ? Gio le colosse, même victime de toutes les déraisons, ne peut concevoir encore moins pratiquer le Mal (seule la cicatrice le mettait en état d’alerte).
Grâce à un enchâssement de récits le lecteur voit défiler des épisodes de la petite histoire, celle de l’intime, reliée à la grande…Ainsi du charnier de la guerre -destin de Gio sénior, aux accents céliniens-, ainsi de l’empire « de la chatte et du plaisir » (La Grand-Mère), de l’empire de la poudre celui que contrôle Fézir « marché de l’amertume et du manque », et la double histoire que l’on colporte sur le coach Henrique d’origine cubaine s’inscrit précisément dans les « divagations », ces interprétations abusives insanes (où les fake news sont détentrices du Vrai).
Un univers de chevaux de vengeance d’honneur de débrouilles de boxe. Un univers âpre ! celui de la Douleur ; mais aussi de l’amour ; amour inviolé que Gio déclame par-delà la mort, (avec Dolorès c’est un voyage à la mer chaque minute) ; amour de Dolorès pour Gio –intact, elle l’emportera dans l’au-delà, elle qui a refusé les avances des prédateurs).
Ce conte se distingue surtout par son écriture ; une écriture où se côtoient le sublime et le loufoque, le lumineux et le sordide, la tendresse et la violence, dans une langue tout aussi rugueuse qu’enflammée, faite de langage parlé et de lyrisme, de brutalité et d’apaisement, langue qui rappelle parfois un requiem -mais organique-, ou la liturgie des mystiques et des révoltés.
-
« Okavango » de Caryl Férey (éditions Gallimard Série noire)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Wild Bunch, la plus grande réserve privée à la frontière namibienne. Son propriétaire ? John Latham, nous le découvrirons progressivement grâce aux investigations de la ranger Solanah Betwase, engagée dans la lutte anti braconnage. Caryl Férey, grâce à un montage alterné et/ou parallèle, et une science du suspense, nous entraîne dans un « jeu de pistes » où le passé s’en vient revisiter le présent pour mieux l’éclairer, où les griffes animales létales rivalisent avec les morsures humaines, où rugissements, feulements barrissements provoquent des frissons, où bourrasques et tempêtes peuvent tout engloutir, où l’humain prédateur serait pire que l’animal sauvage. Laissons-nous entraîner sur les rives del'Okavango, troisième cours d’eau de l’Afrique australe qui traverse le Bostwana, la Namibie et l’Afrique du Sud-, parcourons cette savane dont le rendu, les ambiances sont aux antipodes du « pittoresque » pour cartes postales, écoutons la colère d’un auteur qui s’insurge contre le commerce illégal du trafic d’animaux !
Dédié à Lison petit lion des Grandes Plaines, le roman est composé de deux grandes parties Le Caméléon et Le Scorpion ; si « l’intrigue » -enquête sur la mort d’un pisteur- obéit à une chronologie linéaire, la narration n’exclut pas les nombreux flashbacks sur le passé des personnages principaux, en les inscrivant dans l’Histoire des différents pays du continent africain ! Particulièrement la « guerre de la frontière »(1966-1988) entre l’Afrique du Sud et ses alliés (UNITA) d’une part et de l’autre le gouvernement de l’Angola la SWAPO et leurs alliés (URSS et Cuba), que rappelle à plusieurs reprises le romancier en des pages documentées (d’un point de vue purement narratif cet épisode historique a scellé le « destin » du Caméléon et du Scorpion).
D’emblée, le lecteur est plongé dans un univers « fantastique » comme hors du temps (pour preuve, la numérotation 0 pour le premier chapitre) celui de croyances ancestrales… Mort d’un jeune Ovambo Isra, un pisteur soudoyé par le Baas. Et si la première partie est « dédiée » à John Latham le caméléon c’est avec Rainer du Plessis le Scorpion que débute notre voyage. Un ex gradé de l’armée sud-africaine, dangereux roublard, à la tête d’un empire, lui la bête noire des rangers, risque ce jour dans un restaurant de Nairobi de ne pas honorer la commande la Longue Corne promise à Zeng (20kg de corne de « ce » rhinocéros soit plus d’un million de dollars) Nous comprendrons beaucoup plus tard le destin de son neveu Joost chargé, lui et ses sbires, de capturer l’animal…
Tout le roman est ainsi traversé d’échos, d’effets d’attente ou même de prolepses. De plus, la « binarité » voire la « dualité » semble dynamiser l’écriture. Caméléon -John Latham- et Scorpion -Rainer du Plessis- mais les caractéristiques typiques de l’un valent aussi pour l’autre (Rainer change de look d’identité pour échapper aux rangers tout comme John a changé de « profil » à la fin de la guerre des frontières ; de même il peut se parer des signes distinctifs du scorpion « frapper vite et fort »). Le couple que forme Solanah et son mari Azuel dans la vie peut être entaché par la jalousie et donner quelque piment à l’enquête que la ranger désirerait tant mener seule… Le duo Seth (partenaire officiel de Solanah) et Priti la sémillante (d’abord amoureuse de John elle acceptera de « pister » Seth avant de succomber à ses charmes… et d’œuvrer de concert) ; les acolytes fidèles de John, les San, et le « duo» N/Kon/John, ces « amoureux » des « bêtes sauvages» mettent tout en œuvre pour les « préserver » (en écho inversé Joost et son oncle Rainer, ces trafiquants que Caryl Férey abhorre et comme il l’affirme dans la note d’intention « je voulais être tueur de braconnier quand j’étais petit. Je le veux toujours. Ecrire comme remède (en écho la promesse qui clôt le roman « elle (Solanah) poursuivrait son œuvre à Wild Bunch. Sa guerre contre les braconniers… Et elle les tuerait - elle les tuerait tous. Solanah double fictionnel de Caryl Férey ?
Okavango, un roman où alternent récit et dialogues, réalisme cru (la boucherie des éléphants exigée par le commandant du 32ème bataillon Rainer du Plessis, la prothèse arrachée de One l’unijambiste) et envolées plus lyriques (relation Seth Priti), un roman où certaines descriptions très picturales sont au service d’une fresque aussi odorante que musicale ! -et d’où l’humour n’est pas banni (la physionomie de Solanah, le parler de Wilmine par exemple).
La dualité majeure celle qui oppose(rait) humain et animal s’inscrit dans une autre perspective, la « (ré)conciliation » entre les deux « règnes ». Voici des éléphants qui portent en eux indélébile la mémoire des guerres (à l’instar de Wilmine la grand-mère de Seth ? ou même de John ?) Voici le guépard Ruby, Trust le lion, Dina la femelle rhinocéros et son petit, etc. Biberonnés choyés quand ils sont orphelins, désentravés quand ils sont pris dans de redoutables pièges (cf la girafe)
Laissez-les vivre !
-
« On était des loups » de Sandrine Collette (éditions JC Lattès)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Prix Renaudot lycéens 2022
Prix Jean Giono 2022
Dans ce roman d’espace et de territoire, Sandrine Collette donne la parole à un homme, Liam, un chasseur trappeur que nous allons « écouter penser ». Il dit dans son style proche de l’oralité, imagé et viscéral, tout le chemin parcouru depuis la naissance de son fils Aru jusqu’à une forme de « résilience ». Construit comme un « chemin de montagne abrupt » hérissé de difficultés, avec ses lacets son ascension ses pauses son point paroxystique, sa lente descente vers plus d’apaisement… Car l’essentiel du texte est une chevauchée dans une nature souvent inhospitalière où la frontière serait bien poreuse entre l’humain et l’animal, une nature devenue le réceptacle de ses interrogations.
Un homme se penche sur un enfant, le sien. C’est l’incipit. Un enfant qu’il n’avait pas désiré. Contemplation et retour en arrière. Cette plongée dans un passé récent sous forme de flash-back, est censée « faciliter » la compréhension de comportements à venir ! Qui est Liam ? Installé dès l’âge de 20 ans dans les montagnes, à 4h de cheval de chez Henry et 1h d’avion de la ville, il vivait seul et en autarcie (chasse et vente de peaux de bêtes) jusqu’à la rencontre quasi épiphanique avec Ava, décidée à le suivre dans ce désert d’apparente solitude ! Aru a 5 ans. Liam vit en harmonie avec « son » monde « familial » et le « sien propre », celui de la montagne. Mais au retour d’une chasse, c’est la tragédie : Ava ne l’attend pas, elle ne l’attendra plus. Elle a succombé aux morsures de l’ours. Aru est sauf ! Que faire de l’enfant ?
Le récit de la chevauchée -dans l’espace et le temps- peut commencer.
Un récit qui épouse le flux de la pensée de Liam -un être « bourru » taiseux, qui refuse les faux semblants exprime sans détours sa cruauté. À ses côtés nous allons partager ses « états d’âme », sa conscience aigüe du mal, ses tentations, ses déceptions, ses faiblesses, tout ce qui va faire « basculer » une vie qu’il croyait immuable loin de ladite civilisation urbaine. Sa lucidité est exemplaire là où on serait tenté de le juger pour maltraitance. À travers lui la romancière s’interroge sur l’instinct paternel qui ne saurait être un « acquis » mais qui se « construit ».
Liam sait par expérience que le monde dans lequel il évolue n’est pas fait pour un enfant ; il ne survivrait pas ! Il sait aussi que lui ne peut changer d’univers ! Il décide de le confier à son oncle. « merde je ne le plante pas au milieu des bois quand même » Refus. À partir de ce « non » catégorique quels sont les possibles ? Ceux qu’il nourrit constamment de détours -ce dont témoignent les interrogatives ou la reptation des phrases qui s’insinuent sans ponctuation, dans la simultanéité du style indirect libre et du récit ? Et en contrepartie le champ de l’impossible ? Se rappelant des épisodes de son enfance – et quelques scènes sont restituées dans leur féroce crudité – il affirme de façon péremptoire que les modes d’éducation ont changé, qu’il ne fera pas subir à son fils les outrages dont il fut victime (expiatoire ?) -mais ne condamne pas pour autant la « monstruosité » de son père… Il faut imaginer Aru, 5 ans tel un « adulte » : monter à cheval, chercher des brindilles pour le feu, laver ses vêtements, frémir dans l’attente d’une caresse ou d’une étreinte, et taiseux comme son père ! Et après une séquence dont le traitement rappelle le fantastique (présence menaçante du vieux dans la nuit, rapport de forces inégal, jeux de regards ; mais ne pas spoiler) les rôles s’inversent, et le dernier chapitre (avant l’épilogue) se clôt sur cette bouleversante prise de conscience (au contact de la petite main chaude)« je sais que c’est ce que j’ai de plus précieux au monde » prise de conscience qui préfigure l’excipit les choses sont à leur place je crois.
Liam a compris -et en cela le texte est un roman d’apprentissage - que c’est le môme qui a fait de moi un homme je veux dire avec de l’humanité et pas seulement une machine vivante.
Même s’il n’avait pas de mots pour le dire, Sandrine Collette aura rendu palpables ses doutes, ses monstrueuses pensées, son pouvoir de dominant, par l’emploi d’un vocabulaire très « organique », une syntaxe disloquée -tels des hoquets -, dans la confondante unité du « pensé » et du « ressenti » ! Elle aura cerné au plus près -dans la chair, et de l’intérieur-, la conscience du personnage !
Liés presque charnellement à leurs chevaux Dark et Ball, père et fils auront traversé des « immensités » que les descriptions magnifient en tableaux vivants, -la composition, la répartition espace couleurs, ne sauraient se concevoir sans cette circulation de regards et de sensations : voici entre autres le fameux lac où Ava aurait tant voulu « baptiser » son fils (l’eau lustrale un instant transformée en abysse mortel !!) Père et fils sont, dans leur mutisme réciproque, à l’écoute de tout ce qui anime cette Nature apparemment inviolée. Et le chant des loups (hérésie que de croire à un hurlement !) les émeut particulièrement « ça vient de loin à l’intérieur de moi » constatait dès le début Liam.
« Quelque chose d’irrépressible qui vrille au fond de nos ventres et vient chercher une vieille connivence oubliée du temps où l’univers était une sorte de fusion […] En ce temps-là on était des loups et les loups étaient des hommes, ça ne faisait pas de différence on était le monde »
-
« Les heures heureuses » de Pascal Quignard (éditions Albin Michel)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Composé de cinquante chapitres, le tome XII de Dernier royaume chante les « heures heureuses » dans des perceptions stéréophonies où s’entrelacent aphorismes, histoire, souvenirs, mythologie. Apparemment fragmentés ces chapitres n’en tissent pas moins une trame qui joue avec des variations et qui s’interroge sur la fonction de l’écriture. Non pas simple recension/compilation mais par-delà la juxtaposition Pascal Quignard fait éclater les fulgurances scintillantes d’un monde explosé, que l’écriture « reconstruit ». Ecriture fluide en ses multiples tessitures phoniques, qui va célébrer omnia mirabilia.
Après une « ouverture » sur l’importance de l’heure (chapitres I et II) l’auteur dévoile son projet (chapitre III). Derrière la littera où se tient le perdu, se retient le datum le donné. Ce que fut la donnée dans le réel. Dans ce livre où je veux quitter la lettre il me faut recueillir ces ultimes vestiges : chiffres et dates ; les heures qui les assemblent.
Orderrière les heures ce sont les paysages. Le temps qui se tient derrière le temps c’est la rotation des paysages. Les Heures ce sont les bourrasques de cette tempête originaire qui fuse. Et tout le texte est traversé par le champ lexical des « rouleaux de la mer » jaillissement et rejaillissement, houle, tornade, avec le jeu des polysémies qu’illustrent un amour de l’étymologie, la recherche du mot « juste », sur le plan phonique, l’importance des consonnes fricatives, allitérantes (faire affluer l’afflux) et sur le plan mélodique celle du rythme et des anaphores.
Tout en sachant que l’eau originelle est aussi insaisissable que la nuit est intouchable, tout en sachant aussi que le premier temps est d’eau puis on est expulsé dans l’espace où on tombe avec lui.
Dans sa méditation « océanique », où il prend la mesure du temps, dans sa pensée-rêvée du temps, (loin du temps métrique et pulsatile des portables), il convoque son panthéon littéraire pictural psychanalytique, scientifique aussi (tout en exhumant ceux que l’histoire « officielle » ou « vulgaire » de l’art ou de la littérature a délibérément occultés ou sous-estimés : Claude Mellan, graveur, Jacques Esprit contemporain du duc de La Rochefoucauld, Frenczi psychanalyste, que Freud a vilipendé, entre autres !)
Friand d’anecdotes Pascal Quignard sait restituer la singularité poétique de notre rapport au temps. Nous apprenons que la poétesse Emily Dickinson n’a jamais appris à lire l’heure sur un cadran, que le peintre Eugène Boudin notait sur ses toiles le jour et l’heure où elles lui semblaient achevées, que le Livre d’Heures, ouvrage enluminé, permettait aux fidèles pratiquants de suivre le calendrier des fêtes, que le botaniste Linné a inventé l’horloge florale (rythme des éclosions de fleurs au cours de la journée d’abord le nymphéa blanc, à 7h le millepertuis, à 8h le mouron, à 9h le souci…)
Mais il est un « motif » récurrent, qui lie et relie tous les autres dans une forme d’interdépendance. C’est le « jadis ». À différencier du « passé ». Si le « passé » crypte le mythique le biographique le légendaire, le « jadis » accumule silence, obscurité et profondeur, Le « jadis » : une « pulsion inorientée », celle qui nous « constitue » et qu’il faut accueillir quand bien même on la sait énigmatique et loin de tout repère - conscience mémoire et même langage-. Or ne rejaillit-elle pas dans le présent, ne fait-elle pas ressurgir quelque chose qui aurait été perdu ?
En 1954, une chamane ouïgoure était en train de s’entretenir avec la bru de l’empereur Gengis Khan ; après avoir grommelé les « clés rituelles pour ouvrir les visions » elle renversa la tête. Ce fut un admirable chant sur le jadis qui monta de ses lèvres, « on ne sait plus qui chante de la chamane ou de la reine ».
En sautant du « il » au « je », du passé à un présent intemporel, d’une situation à une autre, de l’étreinte ou du revers de la voix, Pascal Quignard invite son lecteur -comme il le fait pour lui-même- à retrouver ce « songe immémorial » celui d’un temps « profus indivisible ». C’est par exemple dans la quiétude du présent, cette « amitié silencieuse » qu’il avait partagée avec Emmanuèle Bernheim, cette infatigable nageuse, disparue trop tôt à 62 ans (chapitre 27 1955-2017).
L’heurene serait-elle pas « ce lieu qui fait récit » ? Son oscillation ne renvoie-t-elle pas à la pulsation des « tempes » ? une pulsation « sanguine, interne, fœtale, anténatale, pré-atmosphérique » (rien de saugrenu donc dans la juxtaposition temps et tempe chapitre 22 « Tempe du temps » ?)
O vastes fleurs penchées au blanc lavé d’un peu de rose.
-
"Perspective(s)" de Laurent Binet (éditions Grasset)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Roman policier, roman-enquête épistolaire, Perspective(s) nous plonge dans les coulisses du pouvoir des Médicis à Florence en cette année 1557, sur fond de guerres d’Italie, mais aussi, avec la logique de la clandestinité, dans le milieu artistique, -tendances picturales, rivalités, mécénat, affres de la création, contraintes « idéologiques ». Et avec son « espièglerie » habituelle au service d’une immense documentation, Laurent Binet, -à l’instar de Marco Moro le « broyeur de couleurs »-, « triture malaxe » une matière, tisse une toile arachnéenne où l’éclectisme des idiolectes (nombreux correspondants de milieux et cultures différent.es) le dispute à la composition d’une « vaste fresque » (sens propre et figuré). Car à n’en pas douter, le théâtre auquel nous convie dès la fin du prologue un certain B. Laissons le rideau s’ouvrir sur la scène qui est à Florence en 1557 est avant tout une vaste page de littérature.
Clin d’œil aux « classiques » ? Afin de prouver, en la restituant, la véracité des faits et des propos, Laurent Binet « imagine » qu’un certain B. a trouvé une liasse de manuscrits dans une boutique à Arezzo… Déchiffrement et traduction !!! et pour « faciliter » « notre » lecture ce même B. propose une liste des principaux correspondants. C’est la préface/prologue à valeur épiphanique (B. est amené à « revoir » son jugement sur Florence ; oui au mitan du XVI° la capitale toscane était bien « un creuset dans lequel bouillonnaient les passions, un terreau où fleurissaient les génies »).
Le roman s’ouvre sur la mort du peintre Jacopo da Pontormo (tout comme la mort du sémiologue Roland Barthes était l’incipit de La septième fonction du langage) évoquée par la jeune Maria de Médicis dans une lettre envoyée à sa tante Catherine de Médicis le 1er janvier 1557. Il se clôt sur la lettre que Jacopo avait envoyée à Michel-Ange le 29 décembre 1556 et que lui-même a insérée dans celle destinée à Agnolo Bronzino le 10 août 1558. Apparente circularité que cette mise en exergue rétrospective sur les « malédictions » et la « vengeance » ?
Entre janvier 1557 et août 1558, plusieurs « intrigues » sont menées de front dans un époustouflant chassé-croisé : Vasari est chargé par Cosimo de Médicis de mener l’enquête sur la mort (assassinat) du peintre, Strozzi est chargé par la reine de France de récupérer le tableau de Jacopo où Maria est représentée en Vénus dans la douce et lascive oblation de sa chair, alors que des « insurgés » (séditieux Ciompi) menés par Marco Moro se révoltent contre leurs « conditions » - « ouvriers qui ne sont rien aspirant à être quelque chose », que des sœurs catholiques, comploteuses savonarolistes fustigent les « sodomites » ; et après moult « rebondissements » et des effets d’arborescence ou de cercles concentriques (ne pas spoiler) -avec comme acmé les crues de l’Arno,- les dernières lettres sont comme des soupirs funèbres (les disparus, les trucidés, les aspirants à la Mort). La mort omniprésente, la mort à la fois grief motif prétexte, la mort d’une époque d’une forme d’art, mais qui n’exclut pas un art de la conquête, nouvel « Eros et Thanatos »? Cette construction apparente se double d’une composition qui mutatis mutandis rappellerait la Déposition., un enchevêtrement de personnages qui paraît à la fois artificiel et esthétiquement sublime ; un groupe structuré verticalement et reposant sur un sol lisse comme une scène de théâtre ; bien plus le « sens du raccord » -et ce sera une pièce à charge pour l’enquête-, spécificité du peintre n’a-t-il pas lui aussi son équivalent dans le texte littéraire (acidulation excessive des coloris, finesse du trait, beauté du rendu) ? La question mérite au moins d’être posée…
Le romancier en multipliant les points de vue (perspectives) a su pour chaque correspondant établir une corrélation étroite entre son milieu culturel, social, politique et sa « façon de s’exprimer » (idiolecte). Des formules de politesse convenues -voire hypocrites- côtoient des remarques prosaïques (nourriture maux de ventre), des plans très élaborés de stratège dévoilent des architectures insoupçonnées. Des cris d’épouvante indignes de catholiques bienpensants, des propos comminatoires fustigeant une forme de laxisme. Autant le « maître » vieillissant Michel-Ange écartelé entre les objurgations venues de ses commanditaires et ses aspirations profondes fait retentir le glas d’une époque révolue, autant les mesquineries au sein de la famille Médicis frappent par leur amoralité, leur opportunisme et leur cruauté ; autant Agnolo Bronzino est soucieux d’allier esprit et style pour parachever l’œuvre de son maître (la fresque de San Lorenzo) autant Cosimo est avant tout soucieux de « nettoyer » sa ville des séditieux et la perspective d’offrir en pâture la chair humaine (panem et circenses) n’est pas loin de lui déplaire ; autant la jeune Maria n’a rien de la pucelle effarouchée et s’adonne avec volupté aux plaisirs de la chair, autant sa tante mais aussi « son » jeune page pratiquent le double langage ! La dernière lettre du roman (mais la première eu égard à la chronologie) frappe par une forme de spontanéité qui épouse les marques de l’oralité (abondance d’interrogatives et d’exclamatives, de points de suspension, reprises anaphoriques) : un cœur mis à nu avant la mise au tombeau
A une certaine phraséologie typique du XVI°(vocabulaire, tournures, syntaxe) se superpose celle plus récente des Liaisons dangereuses (XVIII°) ; Catherine de Médicis ne joue-t-elle pas avec sa nièce le même rôle que la marquise de Merteuil avec Cécile de Volanges? Et dans les « tracts » de Marco ne lit-on pas des « slogans » qui ne dépareraient pas dans des manifestations actuelles ? « Ce que nous voulons ce n’est pas la République mais la justice qui est l’autre nom de la République pour tous » Des réprobations -infamie de la prétendue justice (Bronzino ne peut que déplorer la corruption ; Florence est une pomme pourrie, le duc un maquereau), cruauté de ces temps pour les défenseurs de l’art et de la beauté entrent en résonance avec des préoccupations actuelles…
La polysémie du mot perspective est induite dans le titre. Multiplicité des points de vue. Acuité de l’enquêteur/détective qui pour déjouer cette « ténébreuse affaire » doit envisager toutes les « possibilités » (tous, amis, ennemis, politiques, artistes, sont de « potentiels » assassins… passer au crible les emplois du temps des uns et des autres, suspicions, enfermement provisoire) Dans le langage pictural la perspective est cette découverte qui a permis de donner l’illusion de profondeur sur une surface plane. Vasari dès le début reproche (entre autres) à Pontormo de n’avoir tenu aucun compte de la perspective dans l’immense fresque de la chapelle (dont le Déluge). Or on sait que le peintre s’en était affranchi dès sa Déposition inaugurant ce qu’on appellera « le maniérisme »… Dans le roman de Laurent Binet, la « perspective » a une fonction narrative et dramatique : elle « sauve » la vie à Vasari -qui en un éclair voit le monde à travers la camera obscura de Brunelleschi- ; technique, elle est sujet de questionnements philosophiques (cf les longues lettres de Michel Ange qui analyse son pouvoir prométhéen) ; esthétique ne peut-elle s’appliquer à la « construction » d’ensemble - premier et arrière-plan, contrastes entre le « plein » et le « délié », l’ombre et la lumière, le sacré et le profane ?
Une érudition sans pédantisme au service d’une fiction où l’auteur -comme dans les romans précédents- se plaît à décontextualiser le factuel tout en le (re)contextualisant, en réinventant un vécu pour chacun des correspondants ! Une fiction non dénuée d’humour (rôle inattendu de Michel-Ange, tribulations du tableau ballotté tel un personnage de BD, commentaires subliminaux, visions dignes de films fantastiques).
Le romancier, double de Michel-Ange, ce Maître vénéré autant que manipulateur ???
-
"Les deux Beune" de Pierre Michon (éditions Verdier)
Colette LALLEMENT-DUCHOZE
Composé de deux « textes » dont le premier a été publié en 1996, le roman de Pierre Michon mêle en une confondante unitédifférentes époques -par une constante collision temporelle- ainsi que la double quête du désir et de l’écriture, -métaphores et musique imposent à la phrase sa structure et ses balancements. Phrase qui ne saurait se détacher de la géographie mythique du Périgord, où le monde vibre dans son entièreté tout comme il a pu gésir dès l’origine. Origine qui précisément -et surtout depuis Courbet-, est inscrite dans le sexe de la femme ! Grottes préhistoriques, peintures pariétales, enfouissements de tous les possibles et de tous les fantasmes. Poissons d’argent qui frétillent dans les deux Beune à la confluence de tous les dangers désirés et refoulés tout à la fois !
Un narrateur -dont le prénom, tel un clin d’œil, ne sera révélé que dans « la petite Beune » s’exprime à la première personne. Le je de l’énonciation se confondant avec le je qui a vécu. Il se penche sur son passé (en recourant au passé simple, à l’imparfait d’habitude et au présent à la fois moment de l’écriture et présent dit gnomique). A 20 ans, il vient d’être nommé instituteur, dans une bourgade du Périgord, à Castelnau. C’est son premier poste.
D’emblée la « description » des « lieux » impose une lecture plurielle : anthropomorphisation (lèvre de la falaise) superposition par fondus enchaînés où passé et avenir ne font plus qu’un dans la fixité d’un présent éternel, appréhension de la Mort, traversée d’un Styx par des nautoniers bavards et bravaches, ces redoutables pêcheurs attablés, une patronne Hélène pythie des temps nouveaux, et cetteValachie où s’engouffrent ironiquement les clichés (j’étais au fin fond de la Dordogne c’est-à-dire nulle part en Valachie). La confrontation avec les élèves en ce mois pluvieux de septembre 1961, le renvoie tout autant au XIX° à l’époque de Jules Ferry qu’aux temps préhistoriques (vitrines de pierres). Et voici la rencontre épiphanique avec Yvonne la patronne du bureau de tabac. On pense à Frédéric Moreau de l’Education sentimentale « ce fut comme une apparition » hormis qu’Yvonne la belle callipyge -qui d’emblée a provoqué le désir- a tout de la bête : « c’était un beau morceau » (le texte sera d’ailleurs traversé par ces formulations rétrogrades et sexistes ; même si elles sont censées être utilisées au sens archaïque, au sens rupestre des choses comme pour les « figures pariétales »…).
Le roman « La grande Beune » est le récit de l’empêchement, de l’inassouvissement du désir. La petite Beune serait-il celui de l’accomplissement ?
27 années séparent les deux textes, mais nous retrouvons les mêmes personnages, la même conjonction du désir et de l’animal, (le renard du tout début qui métaphorisait le désir, les occurrences de la fente, de la carpe, du poisson) peut-être même intensifiée (c’est dire !!!). Et si la pluie a cédé la place au brouillard, l’écran que formait la première se transmue en une forme d’opacité où achoppe la fulgurance du désir. Même dichotomie qui joue avec la gémellité et la sororité et les effets de miroir - les deux Jean, les deux femmes à l’instar des deux rivières, affluents de la Vézère, les tristes compères février et mars, le « trou » découvert le premier soir qui ira se prolongeant en faux tunnel -ce qui n’exclut pas les connotations liées à l’acte sexuel, etc. Même contamination du « style ». La phrase se love sinue emporte la fièvre du désir décollette le fantasme attaché à Yvonne et dans le bruissement du sens qui se marie au bruissement de la Beune, elle dit la source du plaisir, ce flux et reflux des mots, ce souffle cette mélopée qui chante les vertiges, où le « rendu » de la sensualité fait corps avec le couteau de la lune les sequins la lèvre de la falaise les écailles des poissons argent. Dans le questionnement du narrateur, on devine l’entremêlement de l’apprentissage de la langue qu’il doit assumer en tant qu’instituteur/instigateur et du désir réel ou fantasmé (jarretelles du verbe, appâter les hameçons de la grammaire) ; tout le chapitre consacré au fils d’Yvonne dit sans ambages la « monstruosité » de celui qui sacrifie l’innocence à la quête de son désir (à travers les « humiliations » infligées à l’enfant, il fallait provoquer une réaction de la mère, la faire advenir à…)
Au fond d’une grange repose une moissonneuse batteuse ; elle barre l’accès à une grotte qui aurait été « peinte » mais un soir d’ivresse les deux acolytes, les deux Jean, avaient tout nettoyé au Karcher. L’épisode mérite d’être retenu car il éclaire la façon dont procède le romancier dans « La petite Beune » : installer une forme de cérémonial dans l’amplitude d’une phrase complexe -qui va de pair avec la montée du désir – (l’accouplement est un cérémonial -s’il ne l’est pas c’est un travail de chien. La jouissance est une phrase. Longue contournée obéissant à des rites, des formes) puis brutalement ce sera l’éclatement de phrases brèves, énoncés quasi lapidaires tel ce graffiti hic fututa sum (lupanar à Pompéi), le recours au dialogue (dans un texte d’où il est globalement banni) qui privilégie l’oralité ; phrase silex ! « mon silex, mon sens » « le sens est un biface ».
Et c’est rétrospectivement que l’on comprendra mieux le sens de l’exergue emprunté à Andreï Platonov
« La terre dormait nue et tourmentée comme une mère dont la couverture aurait glissé »
- replica hublot big bang
- replica rolex
- rolex replica
- richard mille replica watches
- replica richard mille
- fake richard mille
- richard mille replica
- replica richard mille watches
- richard mille replica watches uk
- richard mille replica
- replica richard mille watches uk
- fake richard mille watches
- luxury richard mille replica watches
- swiss replica richard mille watches
- réplicas de relojes Rolex
- réplicas de relojes
- réplicas de relojes cartier
- réplicas relojes
- replica uhren
- rolex replica uhren
- luxus replica uhren
- répliques de montres rolex
- réplicas de relojes rolex
- fake rolex
- schweizer replica uhren
- gefälschte rolex uhren
- replica rolex uhren
- beste replica uhren
- replica rolex uhren
- rolex replica horloges
- replica horloges
- panerai replica horloges
- luxe replica horloges
- orologi replica panerai
- orologi replica rolex
- falso rolex submariner
- rolex replica watches
- replica watches uk
- patek philippe replica watches
- swiss replica watches
- replica watches
- rolex replica
- fake rolex watches
- luxury replica watches
- super clone watches
- répliques de montres rolex
- répliques de montres patek philippe
- fausses montres rolex datejust
- rolex replique montres
- répliques de montres rolex
- fausses montres rolex
- meilleure répliques de montres
- répliques de montres pour hommes et femmes
- boutique de répliques de montres
- répliques de montres
- répliques de montres suisses
- répliques de montres audemars piguet
- répliques de montres hublot
- répliques de montres rolex
- replica horloges
- réplicas de relógios
- cheap replica watches uk
- rolex replica watches uk
- fake rolex
- rolex replica watches
- Patek Philippe replica watches
- replica rolex watches
- swiss replica rolex watches uk
- hublot replica watches
- replica watches uk
- swiss replica watches
- replica watches
- Audemars Piguet replica watches
- rolex replica watches uk
- fake rolex watches
- rolex replica watches
- replica watches uk
- replica watches uk
- swiss replica watches
- replica watches
- luxury replica watches uk
- cartier replica watches
- Swiss replica watches
- replica watches
- omega replica watches
- replica watches uk
- luxury replica watches
- cheap fake rolex
- replica watches uk
- audemars piguet replica orologi
- orologi replica panerai
- migliori orologi rolex replica
- migliori orologi replica
- orologi replica rolex per uomo
- orologi rolex replica
- orologi rolex replica svizzeri economici
- orologi Rolex falsi economici
- orologi svizzeri replica Omega
- orologi omega replica svizzeri
- falso rolex sea-dweller
- orologi rolex replica di lusso
- svizzeri falso rolex
- falsi rolex submariner
- rolex replica horloges
- nep rolex horloges
- zwitserse replica horloges
- replica horloges nederland
- rolex replica horloges
- luxe replica horloges
- rolex replica horloges
- replica horloges nederland
- panerai replica horloges
- replica horloges winkel
- replica breitling horloges
- replica horloges
- omega replica watches
- omega replica watches
- swiss replica watches
- replica watches
- replica rolex watches
- patek philippe replica watches
- swiss replica watches
- répliques de montres Rolex
- réplicas de relojes Rolex
- rolex falsos baratos
- réplicas de relojes suizos
- réplicas de relojes para hombres
- mejores réplicas de relojes
- réplicas de relojes
- rolex replica uhren
- replica uhren
- breitling replica uhren
- schweizer replica uhren
- replica rolex uhren
- beste replica uhren
- replica uhren für herren
- omega replica uhren
- replica uhren für damen
- omega speedmaster replica uhren
- fake rolex submariner
- rolex replica uhren
- luxus replica uhren
- rolex day-date replica uhren
- replica uhren
- replica watches
- replica watches uk
- luxury replica watches
- swiss replica watches
- rolex replica watches
- replica rolex
- super clone watches
- fake rolex
- replica watches
- replica watches uk
- luxury replica watches
- swiss replica watches
- replica watches
- replica watches uk
- fake watches
- replica watches
- richard mille replica watches
- replica watches uk
- rolex repliky hodinek
- švýcarské repliky hodinek
- falešné rolex
- repliky hodinek v ČR
- falešné hodinky rolex
- švýcarské repliky hodinek rolex
- repliky hodinek rolex
- repliky rolex
- repliky hodinek omega
- falešné rolex datejust
- repliky hodinek breitling
- luxusní repliky hodinek
- repliky luxusních hodinek
- repliky hodinek rolex v Praze
- levné falešné hodinky rolex
©2003 - 2012 Art-Culture-France - Tous droits réservés Mentions légales | Partenaires & Publicités | Plan du site | Contact | www.mairie.com






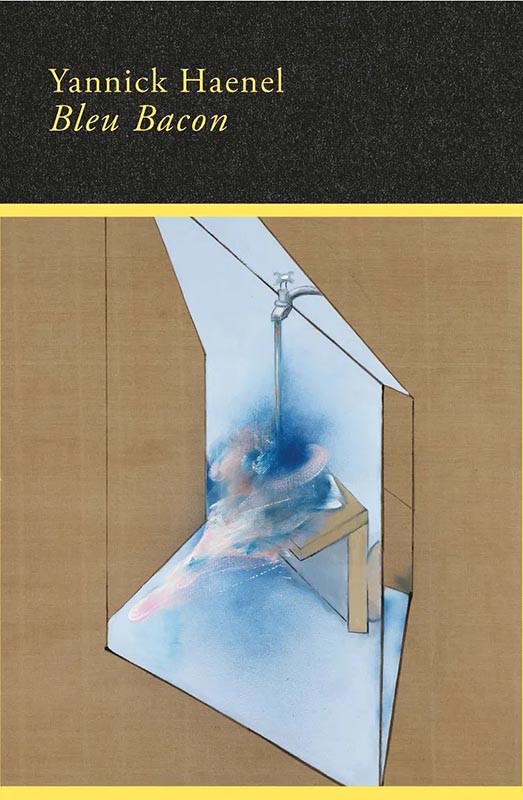
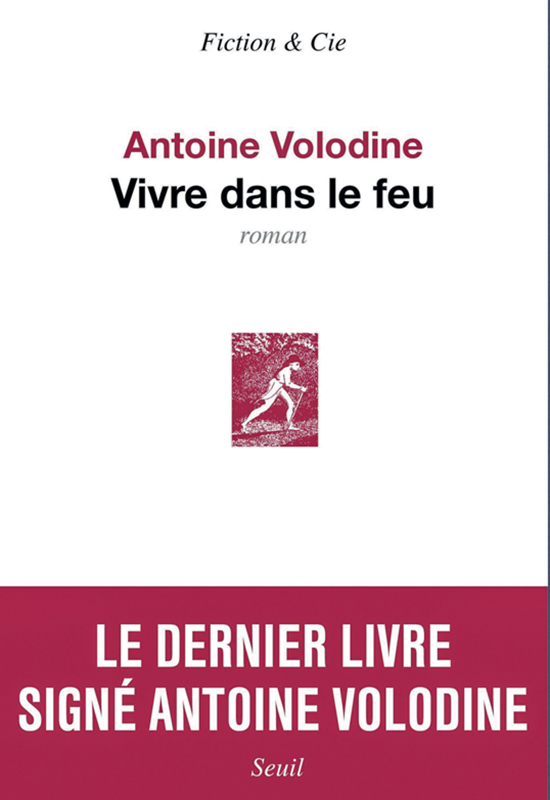

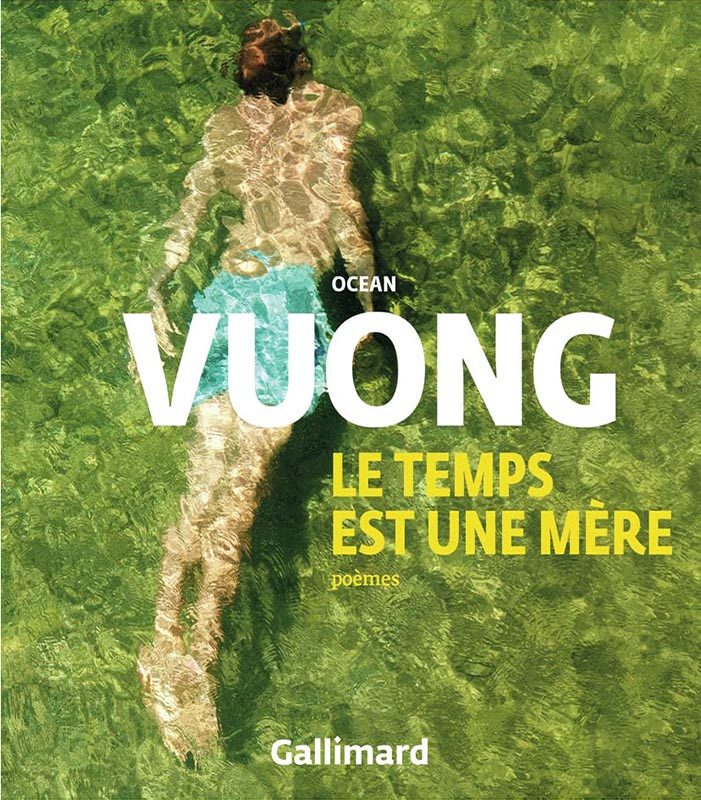

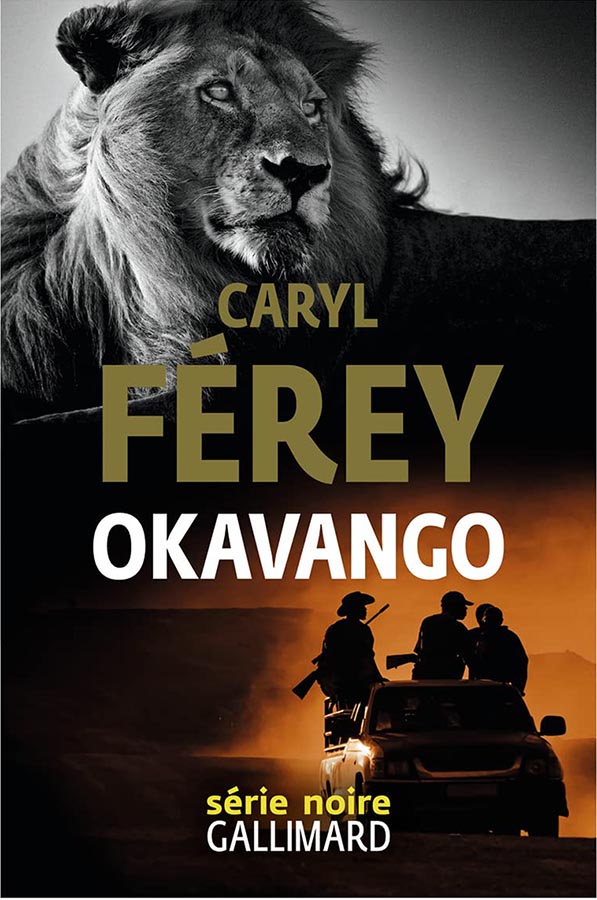
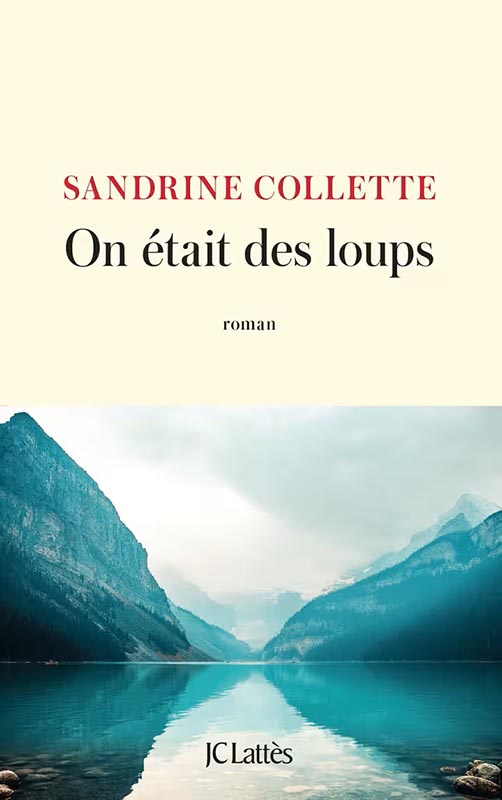
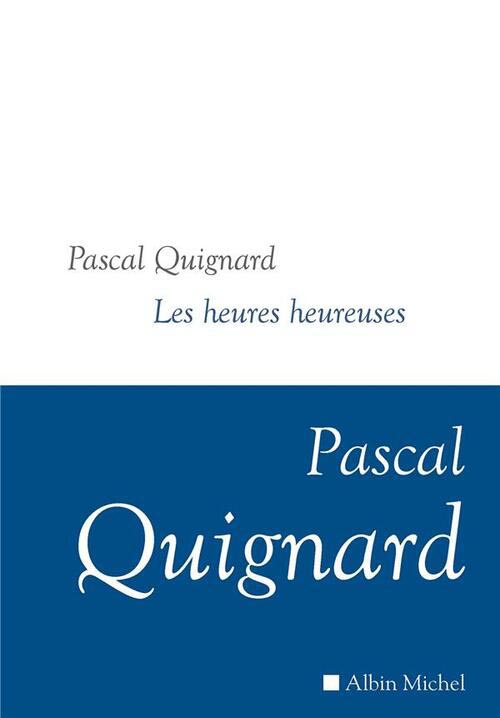
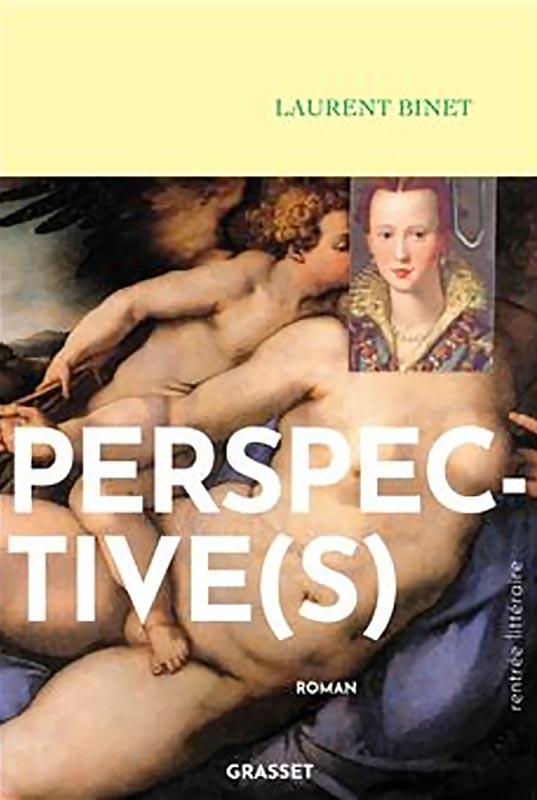
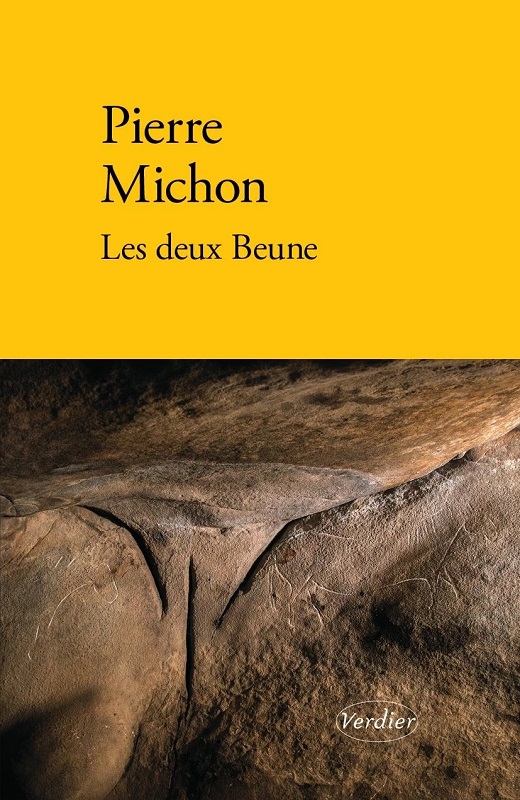
![[Alternative text]](images/pubs/galerie_acf.jpg)